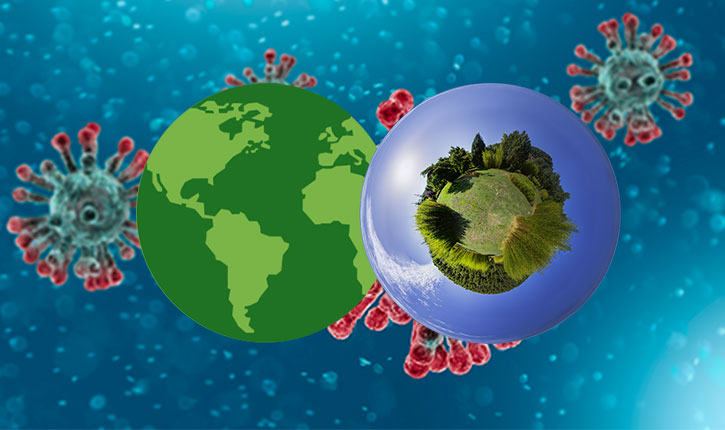
Le capitalisme sauvage et la mondialisation du néolibéralisme ont joué un rôle primordial dans la production des épidémies et des pandémies, y compris en Chine depuis son ouverture au libéralisme économique. Mais par-delà la gestion en cours de la dernière pandémie en date, le coronavirus, Covid-19, l’avenir ne se pose pas, nécessairement, en termes de «printemps des nationalismes», à travers la montée des expressions nationalistes de la révolution conservatrice, mais de restauration de la démocratie et sa réconciliation avec sa nécessaire dimension sociale et du l’Etat providence qui pèse sur les lois de marché et oriente l’économie vers la prise en compte des droits socio-économiques et culturels de la population.
Par Mohamed-Chérif Ferjani *

Le 27 décembre 2019, un hôpital de Wuhan, capitale de la province du Hubei, informe le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCCPM), et la Commission nationale de la santé, de l’existence d’une pneumonie inconnue.
Le 31 décembre, le centre de contrôle de Wuhan admet l’existence de cas de pneumonie inconnus liés au marché de gros de fruits de mer de Huanan.
Après le déni et la sanction du médecin qui fut à l’origine de l’alerte dès le 30 décembre 2019, Li Wenliang, ainsi que de ses collègues qui avaient relayé l’information, l’épidémie est prise au sérieux. La Commission nationale de la santé (NHC) à Pékin a dépêché immédiatement des experts à Wuhan.
Le 8 janvier 2020, la cause de la pneumonie est identifiée comme étant un nouveau coronavirus. Des mesures ont été prises rapidement et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’en est d’autant plus félicitée que les autorités chinoises, contrairement à leur habitude, semblent avoir fait preuve de transparence quant à la gestion de ce qui va devenir une crise mondiale.
En effet, l’épidémie se répand très vite atteignant l’Italie, puis la France, l’Espagne, l’Iran, plusieurs pays en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique, dont en particulier les Etats-Unis et le Canada.
L’OMS a très rapidement déclaré que l’épidémie est devenue, en quelques semaines une pandémie mondiale faisant, depuis son apparition, en décembre 2019, au moins 19.246 morts dans le monde avec plus de 427.000 cas positifs recensés (selon la déclaration du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) datée du 25 mars 2020) et nous n’en sommes qu’au début : depuis, le nombre des morts et des personnes atteintes ne cesse d’augmenter partout, et surtout aux Etats-Unis dont le gouvernement continue à se comporter avec la même irresponsabilité qu’à l’égard du réchauffement climatique et des autres catastrophes qui menacent la planète et l’humanité.
1- Une catastrophe inscrite dans le rapport entre l’humain et la nature :
La pandémie qu’affronte aujourd’hui la planète s’inscrit dans la logique de la tournure catastrophique prise par la volonté prométhéenne de dominer le monde annoncée à l’aube des temps modernes par Descartes dans son ‘‘Discours de la méthode’’ (VIe partie) où on peut lire que la raison et ses exploits dans les différents domaines des savoirs et de la technique, vont permettre «de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature».
Martin Heidegger, tout en considérant que Descartes est responsable de ce péché originel de la modernité où la technique occupe une position hégémonique, rappelle que la science moderne est en son essence «technique», du fait qu’elle est devenue, avec Galilée et Kepler un «projet mathématique» de maîtrise de la nature. (Voir Alain Boutot, ‘‘Heidegger’’, Paris, PUF, 1989.) Tout est, selon cette conception, un simple objet de l’impérialisme de la volonté humaine pour qui le monde n’est plus qu’un réservoir de moyens d’étendre sa domination. La raison humaine elle-même est devenue un instrument de cette volonté qui n’a plus pour finalité, comme chez Descartes et ses héritiers des Lumières, l’émancipation de l’humain et sa réalisation, mais la domination sans limite sur le monde.
Hélas !, comme le remarqua par la suite Hannah Arendt, cette perception prémonitoire des méfaits de «l’arraisonnement» soumettant la raison et la science à «la volonté de volonté» de tout dominer, n’a pas permis à l’auteur de la critique la plus radicale de la technique, comme essence du projet prométhéen de «l’homme moderne», de voir dans le nazisme une extension à la gestion des affaires humaines de cette volonté de domination. Justifiant son adhésion au national-socialisme, il n’y a vu que «la rencontre entre la technique déterminée planétairement et l’homme moderne» en tant qu’elle est «la vérité interne et la grandeur de ce mouvement» qu’est le nazisme. (‘‘Introduction à la métaphysique’’, rédigée en 1936, édition Gallimard, 1980, p 202).
Sans passer de la critique du projet prométhéen de «l’homme moderne» au rejet de la démocratie et à la justification d’un système totalitaire comme le nazisme, d’autres penseurs ont pointé les dérives des progrès techniques mettant en danger les équilibres écologiques. Michel Serres a lancé, dans ce sens, un appel pour un «contrat naturel» comme complément nécessaire du renouvellement du contrat social qu’exige la «coupure brutale» avec ce que nous avons vécu jusqu’ici, y compris sur le plan politique, faisant «que beaucoup de nos institutions se trouvent comme ces étoiles dont nous recevons la lumière et dont les astrophysiciens nous disent qu’elles sont mortes depuis bien longtemps». (‘‘Le contrat naturel’’, Éditions F. Bourin, Paris, 1990) Il identifie l’origine de la conduite humaine à l’égard du monde ainsi : «Nous avons construit un monde où l’intelligence est la première des facultés, où la science et la technique nous tirent en avant et nous chutons, en produisant plus de misère, de famines, de maladies.» (Entretien avec Guy Rossi-Landi – Septembre 1993, ‘‘Le Figaro.fr Scope’’) Pour rompre avec cette attitude, il appelle, dans la préface de l’édition 2018 de son livre, à «élever la Nature au rang de sujet de droit, bouclant ainsi une histoire longue et difficile… Sous peine de mort, il faut donc désormais renverser cette vieille coutume et considérer que nos politiques et notre droit vivent avec et dans le monde, par lui, pour lui et de lui.»
Mais, est-ce seulement le fait de la «condition de l’homme moderne» ? Ne sommes-nous pas devant une nouvelle étape de l’évolution des sociétés humaines fondées sur le postulat de l’anthropocentrisme ?
Certes, dans les sociétés préindustrielles, les humains tirant leur subsistance, au jour le jour, de la cueillette, de la pêche ou de la chasse, puis de l’agriculture et des activités artisanales, n’avaient pas les moyens de consommer tout, jusqu’à l’environnement et la condition de leur existence, comme ils peuvent le faire de nos jours. Cependant, comme le rappelle Pascal Pic («De l’hominisation au développement durable : d’un paradigme à l’autre», communiqué de presse du 25 janvier 2005, et synthèse du débat disponible sur ce lien), cela ne date pas de Descartes, de Copernic ou de Kepler : «Nous avons découvert, en paléoanthropologie, que l’homme appartient à un groupe en voie de disparition en termes de biodiversité (…) Nous appartenons donc à un groupe en voie d’extinction, mais nous avons pu nous redéployer sur la Terre grâce à notre culture : le feu, les outils, les abris nous ont permis d’assurer notre survie grâce à l’innovation et à l’adaptation technologique.»
Ce serait donc la peur de disparaître, face à des prédateurs plus forts que lui, qui a poussé l’humain à inventer des outils qui lui ont permis de devenir, au fil du temps, le plus grand prédateur. Un ethnobotaniste, enquêté par Stéphanie Chanvallon dans le cadre de sa recherche doctorale, insiste sur le rôle de la peur que ressent l’être humain face à la nature dans sa volonté de la dominer : «Je pense que la domination de la Nature a toujours existé. La domination de la Nature est liée à la peur que nous en avons. Quand on n’aura plus peur de la Nature, ça ira mieux. On reste avec un cerveau qui date du Paléolithique et nos représentations sont toujours les peurs de la Nature.» (Stéphanie Chanvallon, ‘‘Anthropologie des relations de l’Homme à la Nature : la Nature vécue entre peur destructrice et communion intime’’, Université Rennes 2009).
En effet, selon Pascal Picq, c’est à l’époque du Néolithique, que l’entreprise de dominer le monde a pris un tournant décisif avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage qui sont des techniques visant à s’apprivoiser les végétaux et les animaux, et par là-même la nature. Outre la consommation et la production, Jean-Pierre Digard souligne les dimensions sociales, culturelles et idéologiques de cette domestication : «[…] variant largement en fonction des ressources naturelles et culturelles disponibles ainsi que des contraintes écologiques et sociales, les techniques ainsi mises en œuvre ont toutes en commun d’être aussi des ‘‘moyens élémentaires d’action’’, selon les termes de Leroi-Gourhan. […] En produisant des animaux, on produit donc également de la domestication, c’est-à-dire du pouvoir de l’homme sur l’animal. La place que celui-ci occupe dans la vie de nombreuses sociétés se traduit en effet par tout un échafaudage d’usages et d’idées, qui va bien au-delà de ce qui serait nécessaire et suffisant pour satisfaire les besoins vitaux de l’animal. On est donc fondé à se demander si ce n’est pas aussi la recherche de la domestication en soi, et de l’image qu’elle renvoie d’un pouvoir sur la vie et les êtres, qui conduit l’homme à produire des animaux.» (‘‘Les Français et leurs animaux’’, Paris, Fayard, 1999, p.71 ; voir aussi son remarquable travail ‘‘L’Homme et les animaux domestiques : anthropologie d’une passion’’, Paris, Fayard, «Le Temps des sciences» 1990).
Depuis la «révolution néolithique», toutes les sociétés qui se sont inscrites dans les évolutions qui n’en sont que le prolongement, n’ont fait que creuser «la distinction séculaire entre l’homme et la nature, distinction qui a eu l’erreur de libérer l’homme des terreurs et des peurs magiques mais qui est en train de provoquer la ruine de l’humanité et le désastre écologique», engendrant «les blessures de l’homme coupé de l’univers et […] les gémissements de la nature exploitée par l’homme», selon l’expression de Richard Bergeron. (R. Bergeron, «Pour une spiritualité du troisième millénaire», ‘‘Religiologiques’’, N°20, automne 1999, p. 231-235, 237-246.)
La mondialisation de la civilisation industrielle et de l’économie capitaliste, rendues possibles par les découvertes maritimes du XVe siècle et de la Renaissance en Europe, notamment avec les conquêtes coloniales et les modèles de développement adoptés, de gré ou de force, par les différents pays de tous les continents, n’est que l’approfondissement de cette rupture entre les humains et la nature, et des blessures que cette rupture a engendrées. De nos jours, la tournure prise par le capitalisme avec la mondialisation du néolibéralisme, qui a enlevé aux Etats les moyens de peser sur les choix économiques et sur leurs impacts sociaux, culturels et environnementaux, n’est pas étrangère à la multiplication des catastrophes : réchauffement climatique, pollution, épuisement des ressources, surexploitation de la terre et de ses habitants, extinction des espèces, séismes, tsunamis, épidémies qui empruntent les chemins de la circulation des capitaux, des marchandises et des humains.
Habib Ayeb a raison de se demander au sujet de la pandémie du coronavirus : «Et si la disparition des abeilles expliquait la naissance d’un certain nombre de virus et d’autres microbes plus ou moins dangereux ? Pourquoi s’interdirait-on de penser que l’usage intensif des produits chimiques dans l’agriculture, tels que les pesticides, les phytosanitaires, les engrais chimiques et autres antibiotiques massivement utilisés dans les élevages intensifs…, qui détruisent les conditions de vie des abeilles, ne produisent pas en même temps les conditions d’apparition de nouveaux virus. Le corona virus n’est-il pas l’un des nombreux ‘‘héritiers’’ possibles des abeilles ?»(1)
A suivre…
Sainte Consorce, le 2 avril 2020.
* Professeur honoraire de l’Université Lyon 2, Président du Haut-Conseil de Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies chercheur associé de plusieurs laboratoires et centres de recherches dont, l’ISERL à Lyon, et Dirasset Maghrébines et l’IRMC à Tunis, auteur de ‘‘De l’islam d’hier et d’aujourd’hui’’, éd. Nirvana Editions et Presses de l’Université de Montréal, 2019, ‘‘Pour en finir avec l’exception islamique’’, éd. Nirvana, Tunis 2017, ‘‘Religion et démocratisation en Méditerranée’’, éd. Riveneuve, Paris 2015/Nirvana, Tunis 2016, ‘‘Le politique et le religieux dans le champ islamique’’, éd. Fayard, Paris 2005, ‘‘Islamisme, Laïcité et droits humains’’, éd. Amal, Tunis, 2012 (l’Hamattan, Paris, 1992), ‘‘Les voies de l’islam, approche laïque des faits islamiques’’, éd. Le Cerf, Besançon/Paris, 1996, et d’un livre autobiographique : ‘‘Prison et liberté’’, éd. Mots Passants, Tunis, 2015, Nirvana, 2019.
Note :


Donnez votre avis