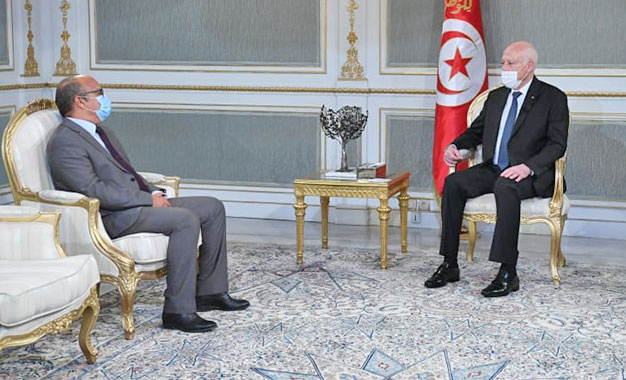
Le match entre le président de la république Kaïs Saïed et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n’est pas près de se terminer, les deux parties campant toujours sur leurs positions respectives, mais on peut d’ores et déjà affirmer que c’est le CSM qui subit le jeu et qui, dos au mur, ne va pas tarder à jeter l’éponge, car non seulement il a mal engagé les hostilités, mais il avait opté, dès le départ, pour une mauvaise tactique, celle de l’attentisme et de l’inertie.
Par Ridha Kefi

Dès le début des hostilités lancées par le chef de l’Etat, bien avant l’annonce des mesures exceptionnelles le 25 juillet dernier, le CSM a cru pouvoir s’adosser à une bien vague légalité constitutionnelle pour opposer à ses détracteurs une fin de non-recevoir. Se croyant intouchable, il s’est cramponné à une légitimité fortement contestée et qui est battue en brèche de toutes parts, y compris au sein de la corporation. Et à juste titre…
Une «justice» de compromis et d’arrangements
En effet, non seulement le CSM souffre d’une «maladie congénitale» liée à sa genèse même, puisque l’élection de ses membres a été marquée par des compromis et des arrangements entre partis politiques, mais la plupart de ses décisions – qu’il s’agisse des (très rares) mesures disciplinaires ou du mouvement annuel dans le corps de la magistrature – ont toujours porté une forte empreinte de ces mêmes compromis et arrangements. Ce qui affaiblit énormément la prétention de ses membres à l’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, car quel bénéfice pourraient tirer les justiciables d’une justice qui s’émancipe totalement de l’influence du pouvoir exécutif pour se mettre aussitôt sous celle des partis politiques? Aucun…
L’autre point faible du CSM, et il est dépendant du premier, réside dans le fait qu’il a une très mauvaise presse et son image dans l’opinion publique est on ne peut plus négative. En effet, cette opinion publique n’est pas dupe des rapports incestueux entre un pouvoir judiciaire trop dépendant de la partitocratie dominante et des partis politiques qui ne cessent d’appeler, hypocritement, à l’indépendance de la justice.
La mascarade a trop duré et la gestion, trop corporatiste pour être juste, des dossiers des deux grands magistrats accusés de corruption, Béchir Akremi, ancien procureur général de la république, et Taieb Rached, ancien président de la Cour de cassation de Tunis, a fini par révéler les limites de la soi-disant indépendance de cette instance et son incapacité à réformer une profession qui s’était longtemps dévoyée en se mettant au service des régimes successifs.
Le refus d’avancer sur la voie de la réforme
Par ailleurs, et comme pour apporter de l’eau au moulin de ses détracteurs, le CSM n’a montré, depuis sa création, aucune volonté d’avancer sur la voie de la réforme : ses décisions hésitantes et mitigées, plus soucieuses de plaire aux lobbys politiques et aux groupes d’intérêt que d’assainissement d’un «pouvoir judiciaire» très décrié, ont apporté la preuve, si besoin est, que dans sa composition actuelle, cette instance est devenue plutôt un obstacle à toute réforme sérieuse, et non un simple ravalement de façade.
Sur un autre plan, et face aux «pressions» du président de la république, qui les exhortait à jouer pleinement leur rôle dans l’assainissement de la scène politique nationale, gangrenée par le népotisme, la corruption et l’argent sale, les membres du CSM se sont braqués et, au lieu de montrer une volonté sincère de s’associer à cette œuvre salutaire, portée à bout de bras par tout un peuple, ils ont préféré opposer une fin de non-recevoir, se complaisant ainsi dans une sorte d’inertie volontaire et se prévalant d’une «indépendance» synonyme d’immobilisme et d’irresponsabilité.
Une «justice» au service des partis
Pour ne rien arranger, et persévérant dans l’erreur, ces chers magistrats ont cru bien faire en cherchant le soutien intéressé à leur cause des partis politiques opposés au président de la république et qui ont perdu toute crédibilité aux yeux de l’opinion publique. S’ils voulaient prouver leur soumission à certaines «machines politiques» qui ont mené le pays, de crise en débandade, au bord de la faillite qui le menace actuellement, ils n’auraient pas fait autre chose.
N’est-il pas à la fois éclairant et désespérant – pour les justiciables – de constater que ce sont les partis et les figures politiques ayant conduit le pays au cours des dix dernières années, avec les résultats catastrophiques que l’on sait, qui soutiennent aujourd’hui le vrai faux «combat de l’indépendance de la justice»?
S’il faut une autre preuve des mauvaises tactiques suivies par le CSM dans sa «guerre» contre le président de la république, la plus grave à nos yeux est d’avoir tout fait jusque-là à l’envers, en fournissant sans cesse des arguments à ses détracteurs, qui n’en demandaient pas tant, et le plus important de ces arguments consiste dans la «politisation excessive» de beaucoup de magistrats qui n’hésitent pas à afficher publiquement leurs obédiences politiques et à prendre parti contre tel parti ou pour tel autre, y compris sur les réseaux sociaux où beaucoup d’entre eux sont très actifs.
Le combat, le vrai combat, des magistrats devrait être livré contre l’image négative qui leur colle dans l’opinion. Et la «guerre» que certains d’entre eux mènent contre le président de la république n’est pas seulement contre-productive, mais elle ne risque pas d’améliorer cette image. Au contraire, elle pourrait aggraver leur cas. Et ce serait dommage pour la jeune et fragile démocratie tunisienne de ne pouvoir compter sur une véritable justice républicaine, enfin débarrassée de ses propres démons.
Articles du même auteur dans Kapitalis :
Avons-nous aujourd’hui en Tunisie de vrais hommes et femmes d’Etat ?
Tunisie : L’UGTT est-elle une vache sacrée ?
Tunisie : Comment Fadhel Abdelkefi pourra-t-il décoller dans les sondages ?


Donnez votre avis