La connaissance de l’Histoire, pour biaisée qu’elle soit, demeure salutaire pour éviter les erreurs qui en ont émaillé le cours, grâce au sens critique, sans jamais perdre de vue l’effet du temps et l’ingratitude des mémoires. La relecture de ‘‘L’Histoire’’, le célèbre essai de l’historien des civilisations britannique Arnold Toynbee, le prouve, y compris par ses parti-pris, ses silences et ses oublis.
Par Dr Mounir Hanablia *
L’Histoire a-t-elle un sens, une direction, une signification, ainsi que l’ont signifié les deux tunisiens, St Augustin et Ibn Khaldoun? Selon Arnold Toynbee, dans la perspective occidentale chrétienne qu’il partage, la réponse ne fait aucun doute. Son œuvre monumentale analyse la naissance, la croissance, l’apogée, le déclin, la mort, la renaissance, l’influence mutuelle des civilisations, en s’inspirant des nombreux exemples qui jalonnent le cheminement historique de l’humanité.
C’est là, à tout le moins, la vision d’un biologiste analysant un organisme vivant, sa création, et essayant d’en prévoir autant la fin que le cheminement des gènes dans les cellules d’autres êtres vivants. Et on peut comprendre qu’à l’époque actuelle un Yuval Harari ait pu envisager le cheminement de l’humanité selon une perception informatique, celle des échanges d’informations et des algorithmes.
Occident hellénique et cultures barbares
Mais Toynbee, un sujet britannique, a réalisé son effort de réflexion avant la désintégration de l’Union Soviétique, et l’accession de la Chine à l’économie de marché. Cependant l’intérêt n’en est pas altéré, bien au contraire. Si l’hypothèse d’une alternative chinoise à la civilisation mercantile occidentale que le cours chaotique du Maoïsme avait laissé entrevoir dans les années 60 du siècle dernier, fait aujourd’hui sourire, le travail de synthèse de l’historien, à la recherche de repères dans le cheminement du temps, est impressionnant.
Le temps et la mémoire sont les domaines dans lesquels le travail de recherche réalise un tri afin de déterminer ce qui est utile, ce qui est conforme aux normes mentales du chercheur, issues de l’éducation, du champ culturel, de ce qui ne l’est pas. Et en agissant ainsi l’historien s’expose inévitablement à la critique, celle de ne pas être objectif, mais peut-on lui faire grief de se faire ainsi le reflet de sa propre personnalité?
De surcroît, étant spécialiste de la Grèce et de Byzance, il était presque inévitable que ce que Toynbee a appelé hellénisme en constitue la référence principale. Cependant le concept d’hellénisme est indubitablement une frontière, une de plus, établie par les Grecs depuis Marathon, puis l’Occidental qui prétend en hériter, contre les autres cultures, celles barbares évidemment, dont d’emblée tous deux se distinguent par leur refus d’en faire partie. Et les opinions de Toynbee relativement aux différentes manières dont une civilisation militairement vaincue triomphe de ses vainqueurs n’est que le reflet de cette inquiétude de l’immigration que l’anglais impérialiste témoigne vis-à-vis de la reconstitution à l’intérieur de l’espace de la souveraineté, des communautés exogènes et de leur culture, dont selon lui, l’Etat inévitablement ne pourra venir à bout.
C’est une perspective semblable qui a plus tard conduit au Brexit. Mais face à l’Hellénisme des Macédoniens puis des Romains, l’historien distingue les civilisations qu’il qualifie de syriennes, toutes celles qui ont éclos entre la Méditerranée, les limites sud du plateau anatolien et de l’Arménie, l’Est des monts Zagros du plateau iranien, et le nord du désert d’Arabie. Elle englobe ainsi le Cham (Syrie, Palestine, Liban, Jordanie) et la Mésopotamie. Mais peut-on comparer Jérusalem à Babylone?
Religions et civilisations
En réalité, le concept de civilisation syrienne est surprenant. A première vue, elle peut être considérée comme une variante de la civilisation mère mésopotamienne, mais elle occulte la Phénicie et Carthage, parce qu’elle met en lumière Judah et Israël, annonçant l’arrivée du christianisme puis de l’islam.
Il est intéressant de constater que ces deux grandes religions monothéistes ne sont pour l’historien qu’un même emprunt de l’hellénisme à la civilisation syrienne, même si la classification des catégories civilisationnelles dans ce livre se base fondamentalement sur le fait religieux.
C’est là déjà une relativisation de l’antagonisme islamo-chrétien, surprenante de la part d’un auteur britannique héritier des croisades et de Richard Cœur de Lion, mais néanmoins louable, même si le culte et le crédo chrétiens ont plus à voir avec ceux qui avaient cours dans la Rome païenne.
Quant au fait juif dans l’historiographie occidentale, l’évocation de l’introduction des lois issues de l’Ancien Testament dans le Codex de Justinien de l’Empire Byzantin est déjà un autre sujet d’étonnement dont il est difficile d’évaluer les conséquences. On aura beau arguer de la longévité du judaïsme, ne faut-il pas l’envisager à la lueur du triomphe des religions dont il a été l’une des principales sources d’inspiration? Et-ce là l’opinion d’un chrétien protestant ? Et ce destin exceptionnel supposé n’est-il pas l’émanation de l’esprit d’un protestant anglican?
On pourra par ailleurs remarquer la place démesurée qu’il accorde au Bouddhisme Mahayana simplement du fait de sa diffusion en Chine, alors qu’il est loin d’y constituer le fait social déterminant. Mais c’est toujours les mêmes choix de l’historien qui se manifestent ainsi; le bouddhisme est important parce qu’il a selon lui servi de véhicule à l’hellénisme en Asie, dont la preuve est constituée par la diffusion d’une esthétique artistique de synthèse gréco indienne jusqu’aux confins de la Chine.
Dans toute cette construction intellectuelle, l’Iran, dont l’auteur reconnaît tout de même au Zoroastrisme un rôle déterminant dans l’élaboration de l’eschatologie juive, est singulièrement absent. Et on ignorera toujours son influence, ainsi que celle de l’Inde, dans l’élaboration du stoïcisme qui a tant influencé le monothéisme, et de l’épicurisme, cette philosophie de la jouissance qui n’est pas sans rappeler le tantrisme hindou et qui est à la base du matérialisme athée occidental à l’origine du modernisme.
La place et le rôle de Carthage occultés
Enfin, la dernière remarque qu’on pourra faire c’est évidemment le rôle de Carthage dans l’Histoire, totalement occulté. Carthage fut une cité marchande, la plus importante parmi toutes, établie par les Phéniciens avec à sa tête un sénat et des institutions et qui disposait d’une marine importante avant même l’ascension de Rome. Et les Phéniciens ayant diffusé leur alphabet dans tout le monde connu, il n’est pas interdit de penser qu’ils eussent constitué les professeurs de la civilisation grecque, tout comme les Grecs le furent pour les Romains.
Pourtant c’est uniquement en tant qu’ennemie de Rome que Carthage est passée à la postérité par le biais des auteurs latins, même si l’auteur de sa destruction, Scipion l’Emilien, avait pleuré en pensant à l’avenir de Rome. Mais si l’hellénisme est demeuré aussi important dans l’historiographie occidentale c’est peut-être parce que les Grecs, les Romains, et leurs héritiers, les Occidentaux, ont tenu à narrer les faits de leurs temps, selon leur vision de l’Homme, et une narration semblable dans les civilisations rivales, en particulier celle de Carthage, a été sans doute perdue, ou occultée.
Rien ne prouve que l’Histoire n’ait été le plus souvent que le résultat aléatoire de batailles gagnées ou perdues sur des détails insignifiants comme Zama, ou à ce qu’on dit, celles de Poitiers (732 et 1356) ou encore Waterloo. Rien ne dit que l’Histoire aille toujours dans le sens de ce que l’on nomme progrès ou civilisation. Les dégâts environnementaux irréversibles et le spectre de l’holocauste nucléaire doivent nous rappeler l’anéantissement de tous ceux qui se sont pris pour des Dieux dans la mythologie grecque.
Il est opportun de se remémorer ce verset du Coran qui a hérité de la Bible sa lecture déterministe du cheminement historique où Dieu annonce aux Anges sa décision d’installer sur terre un Représentant (Calife), autrement dit l’être humain; ces derniers demandent pourquoi il installerait celui qui y ferait le mal et ferait couler le sang et Dieu répond qu’il sait ce qu’ils ignorent. Autrement dit, le savoir est ce bien supérieur qui légitime la prééminence de l’être humain et rend le mal et l’effusion de sang dérisoires, quand il ne les prévient pas. La connaissance de l’Histoire, pour biaisée qu’elle soit, demeure donc salutaire pour éviter les erreurs qui en ont émaillé le cours, grâce au sens critique, sans jamais perdre de vue l’effet du temps et l’ingratitude des mémoires.
* Médecin de libre pratique.
‘‘L’histoire’’, essai de Arnold Toynbee, traduit de l’anglais par Jacques Potin et Pierre Buisseret, éditions Payot, Paris, 3 janvier 1996 714 pages.


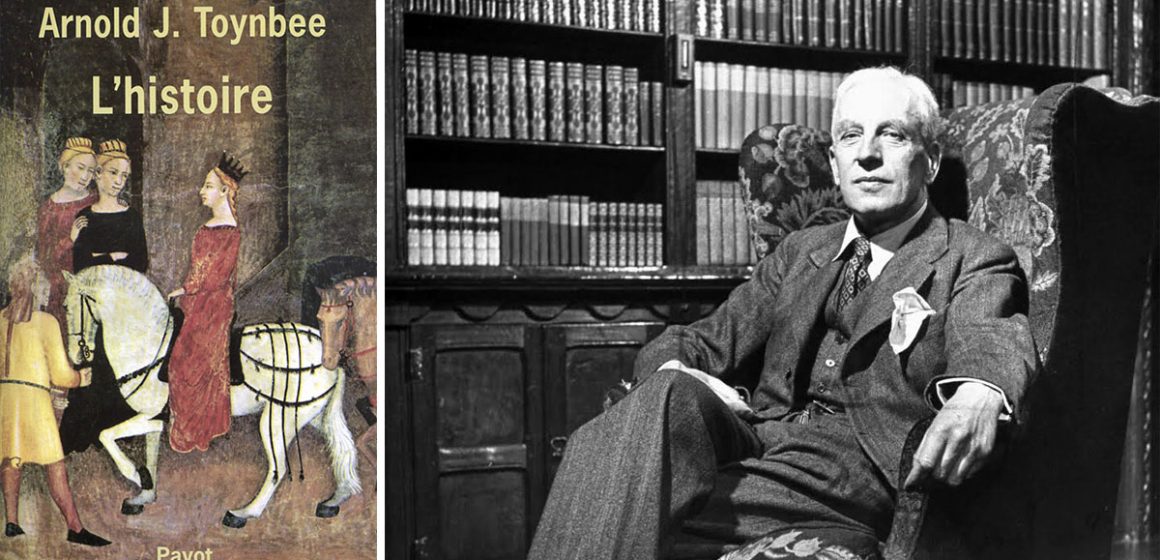
Donnez votre avis