Au cours de ce mois de juin 2025, quatre juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont été sanctionnées par les États‑Unis : gel de leurs avoirs, interdiction de voyager. Leur seul tort ? Avoir autorisé des enquêtes et ordonné des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu, pour crimes de guerre présumés — une simple application du droit international. Elles ont été punies pour avoir fait ce qu’un tribunal implanté en 2002, ratifié par 125 pays, est censé faire : juger les crimes contre l’humanité. (Ph. Les Nations unies sont de plus en plus marginalisées et impuissantes face aux diktats des puissances).
Khemais Gharbi *
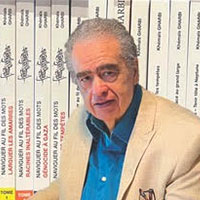
À vingt ans, j’adorais le mot «droit international». Il brillait dans ma tête comme une étoile fixe, un rempart invisible contre les horreurs du passé. J’y voyais une conscience supérieure, née des cendres des guerres, une promesse faite à l’humanité tout entière : plus jamais cela. Le monde, croyais-je, s’était doté d’un langage commun, impartial, sacré. Au-dessus des intérêts, au-dessus des armes.
Mais à quatre-vingts ans, ce même mot me paraît usé, affadi, comme un drapeau qu’on hisse à moitié, ou qu’on range selon la météo.
Le droit international n’est plus cette boussole morale que je rêvais adolescent. Il est devenu l’ombre portée du pouvoir : clair quand il sert les forts, flou quand il dérange, absent quand il condamne les alliés.
À 80 ans, on n’a plus besoin de longues démonstrations. Il suffit d’observer. J’ai vu, au fil des années, ce mot prononcé avec solennité dans certains débats — jusqu’à dix-sept fois dans une seule émission évoquant l’Ukraine ou l’Iran. Et j’ai vu, dans les mêmes studios, le silence peser sur Gaza, où le droit semble avoir déserté les ruines, les enfants amputés, les files d’attente mitraillées. Une seule fois, ce mot sacré y fut murmuré. Une seule fois. Comme une gêne.
Et quand un tribunal, fût-il international, ose rappeler la règle… il est sanctionné.
Ironie récente, amère vérité
Au cours de ce mois de juin 2025, quatre juges de la Cour pénale internationale ont été sanctionnées par les États‑Unis : gel de leurs avoirs, interdiction de voyager. Leur seul tort ? Avoir autorisé des enquêtes et ordonné des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu, pour crimes de guerre présumés — une simple application du droit international. Elles ont été punies pour avoir fait ce qu’un tribunal implanté en 2002, ratifié par 125 pays, est censé faire : juger les crimes contre l’humanité.
Les juges sanctionnées par Washington — Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Alapini‑Gansou, Beti Hohler — n’ont enfreint aucune règle, sauf celle que la puissance veut préserver. Washington a dénoncé leurs décisions comme «illégitimes» et menaçantes pour la «souveraineté» américaine et israélienne.
À qui le droit appartient-il ?
C’est là que mon regard de vieil homme se fige. Le droit international, tel qu’on le voit s’appliquer aujourd’hui, n’est ni un droit, ni vraiment international. C’est un décor. Une mise en scène. Une épée qu’on prête à certains, qu’on retire à d’autres. Une illusion de justice quand elle est commode; un silence assourdissant quand elle dérange.
À vingt ans, j’aurais crié. Aujourd’hui, j’écris. Non pas par résignation, mais par lucidité. Car ce n’est pas le droit lui-même que je renie, mais l’usage inégal qu’on en fait. Il faudrait le rendre à son peuple, à sa source, à ses victimes. Il faudrait oser le nommer quand il protège les faibles, non quand il justifie les forts.
Le droit international n’est pas perdu. Il est juste pris en otage.
Mais les mots, eux, demeurent. Et tant que des juges auront le courage de dire la vérité — même au prix de leur liberté — il restera une flamme quelque part.
Et le regard d’un vieil homme pour l’entretenir.
Ecrivain et traducteur.



Donnez votre avis