
L’agriculture a montré une certaine résilience face aux effets de la pandémie de la Covid-19 en assurant, en période de confinement total, la couverture de la demande alimentaire dans des conditions relativement correctes et sans rupture de l’approvisionnement des marchés et de l’industrie agroalimentaire. Toutefois, depuis la sortie du confinement et le retour à la normale, les problèmes de fonds ont de nouveau émergé, aggravés par les dérives de la gouvernance du secteur. De fait, il s’avère ainsi que cette résilience n’était que conjoncturelle et qu’elle ne devrait pas cacher les vrais problèmes que rencontre le secteur agricole et les défis auxquels il est appelé à faire face dans le futur proche.
Par Mohamed Elloumi *
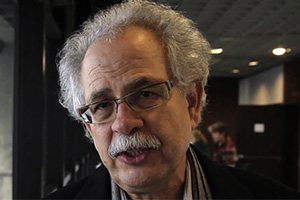
L’agriculture tunisienne fait face, depuis un certain nombre d’années, à une crise systémique et doit relever dans le court terme un ensemble de défis afin d’assurer la durabilité des systèmes de production et d’éviter le risque d’effondrement qui menace l’ensemble du secteur.
Ainsi, à l’incertitude dans laquelle sont plongés les acteurs des différentes chaînes de valeurs, s’ajoute la désorganisation des filières dont profitent certains intermédiaires qui tirent parti également de l’atermoiement des responsables politiques.
À titre d’exemple, la situation que connaît le secteur des dattes est symptomatique. En effet, les propriétaires des chambres froides qui sont le premier maillon de la chaîne de valeurs et qui ont pour habitude l’achat des régimes sur pieds à partir du mois de juillet, ne sont que faiblement intervenus cette année, laissant les agriculteurs dans l’incertitude la plus totale face à l’effondrement des prix à la production. De même, la récolte des pommes dans les hauts plateaux de Kasserine est compromise du fait de la frilosité des grossistes face à l’incertitude et le risque d’un retour de la Covid-19. Tout cela alors que les consommateurs paient au prix fort ces deux produits phares de l’agriculture tunisienne.
Pour faire face à ces menaces, la réponse ne peut être que par l’innovation technique, économique et organisationnelle, qui permet d’améliorer l’efficacité des itinéraires techniques, d’adopter de nouveaux modèles économiques et d’explorer de nouvelles formes d’organisation capables de renforcer le positionnement des agriculteurs dans les chaines de valeurs.
L’agriculture tunisienne doit sortir du modèle des années 1970
Il s’agit dans un sens de faire en sorte que l’agriculture puisse sortir du modèle de la révolution verte qu’elle a adoptée dans les années 1970 et qui a atteint ses limites, et de faire une révolution doublement verte qui allie performance économique, inclusion sociale et respect de l’environnement en se basant moins sur l’artificialisation du milieu et les intrants chimiques que sur l’exploitation des fonctionnalités même des écosystèmes et qui prenne en considération à la fois l’amélioration de la productivité et la durabilité dans ses différentes dimensions, économique, sociale et environnementale.
Pour la construction de ce paradigme, le rôle de la recherche est central et rien ne peut être entrepris sans une recherche agronomique de pointe, car du fait même de la nature des problèmes à résoudre, le transfert de technologies venant des pays plus développés, voire même des centres de la recherche internationale, ne seront pas adaptés à notre contexte.
De fait, la recherche agronomique tunisienne a toujours apporté sa contribution au projet de développement que se donnait le pays à chaque période de son histoire.
Ainsi, durant les années 1960, dans le cadre de ce qui a été décrit comme «le développement construit», la recherche a apporté sa contribution en identifiant de manière précise le potentiel agricole du pays à travers l’élaboration de carte phytoécologique ou encore en contribuant largement à l’élaboration d’un plan optimum de l’agriculture tunisienne.
De même durant les années 1970 avec l’adoption par la Tunisie du modèle de la révolution verte, la recherche a été mobilisée pour l’introduction et l’adaptation des variétés à haut rendement pour les cultures céréalières, puis en fournissant des variétés mieux adaptées au contexte tunisien. Durant les années 1980 et 1990, la recherche a accompagné la révolution de l’irrigation en fournissant des paquets techniques et les modèles de conduite pour les différentes cultures.
De nos jours, malgré la réduction des moyens et la dispersion des efforts, la recherche continue à apporter des réponses aux problèmes que rencontre l’agriculture tunisienne, et permet ainsi d’améliorer la productivité et la résilience des systèmes de production.
Toutefois, les enjeux semblent être d’une nature toute différente et la recherche agronomique, malgré des acquis importants et une tradition de proximité avec les acteurs du secteur agricole, risque de ne pas pouvoir apporter sa contribution pour relever les défis. En effet, elle traverse, elle aussi, une crise profonde, crise de financement, de ressources humaines et de gouvernance.
Sans qu’il soit possible de faire ici une analyse détaillée des origines de cette crise et de ses implications sur le secteur agricole, je rappellerai quelques-unes de ses dimensions.
La faiblesse des ressources humaines et leur dispersion
L’ensemble du système de recherche et d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP) qui travaille directement pour la recherche agronomique compte environ 800 enseignant-chercheurs dont la moitié sont des enseignants et donc travaillent à mi-temps pour la recherche. Cela fait donc moins de 600 chercheurs à plein temps travaillant sur un secteur (agriculture, pêche et aquaculture) qui pèse globalement 10% de l’économie et emploie environ 15% de la population active. À cette faiblesse des moyens humains s’ajoute leur dispersion sur un grand nombre de centres de recherche.
En effet, l’autre mal dont souffre la recherche agricole tunisienne c’est l’éparpillement des moyens. Ainsi pas moins de 23 centres et instituts de recherche et d’enseignement supérieur agricoles sont répartis sur l’ensemble du territoire national et comptent en tout près de 850 enseignants-chercheurs ce qui fait une moyenne d’environ 38 chercheurs par institution. Sachant que les cinq plus gros centres comptent une moyenne de 70 à 80 chercheurs, cela fait baisser la moyenne pour ceux qui restent à environ 20 chercheurs qui souvent travaillent sur des thématiques diverses à côté de l’enseignement et sont loin d’atteindre la masse critique de chercheurs nécessaire à la conduite d’un programme de recherche digne de ce nom.
La question de la gouvernance et la double tutelle
La gouvernance de la recherche agronomique est assurée par l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricole (IRESA). Cette institution qui se caractérise par ses nombreux services et la pléthore de ses employés pourrait être assimilée à une université d’enseignement et de recherche agronomique. Or il n’en est rien, puisque ni le président, ni les directeurs généraux ne sont élus et pire encore, il n’existe pas de par les statuts de cette institution un organe scientifique ou/et pédagogique avec des représentants élus comme c’est le cas des universités. Un Conseil supérieur de la recherche agronomique existe bien sur le papier, mais de mémoire de chercheur, celui-ci ne s’est pas réuni une seule fois les 10 dernières années.
Il en de même du périmètre d’intervention de cette institution qui normalement devait se limiter à la coordination et la mise en cohérence des activités des instituts sous tutelle. Or, au cours du temps, elle a empiété sur les activités de ces centres en assurant la coordination de projets de recherche, reléguant les chercheurs des centres sous-tutelle au rôle de simples exécutants.
À ces faiblesses de la gouvernance au niveau du MARHP s’ajoute la problématique de la double tutelle puisque le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) assure aussi sa tutelle sur la carrière des chercheurs et contribue au financement des structures de recherche : laboratoires et unités de recherche. Sans oublier enfin la tutelle des universités pour certains instituts, mais pas tous !
Cette double tutelle conduit à une confusion des rôles entre le MARHP et le MESRS. En effet alors que le MARHP supporte la plus grande part du financement de la recherche agricole (salaire des chercheurs et de tout le personnel, bâtiments et frais de fonctionnement, en plus du financement de certains projets), le MESRS, à travers les structures de laboratoires, apporte un financement à minima et s’attribut de fait la paternité de la quasi-totalité du travail des chercheurs.
Le problème de cette double tutelle se pose aussi en termes de priorité et de pilotage de la recherche. En ayant le label du MESRS, les chercheurs échappent, et parfois c’est tant mieux, à la tutelle pesante de l’IRESA. Cela leur permet une plus grande liberté dans le choix des thèmes, ce qui est en soi souhaitable pour un chercheur, mais peut les éloigner des vrais problèmes de l’agriculture tunisienne.
Tout cela se traduit par l’absence de visibilité pour les chercheurs sur le moyen et le long terme.
Quand on sait qu’un programme de sélection variétale se réalise sur 4 à 10 années, on comprend comment le manque de visibilité en l’absence de financements pérennes (sous la forme d’une loi de programmation pluriannuelle, par exemple) les oblige à adapter en permanence leur programme de recherche aux sujets à la mode dans la sphère des institutions internationales et celle des bailleurs de fonds, pour espérer décrocher un financement.
L’absence de pilotage et de stratégie à long terme
Soumis à une double voire triple tutelle, les instituts de recherches et les chercheurs se trouvent sans directives claires et sans boussole pour guider leurs activités de recherche.
À l’absence d’une vision claire, à la hauteur des enjeux et issue d’une approche prospective basée sur la participation de l’ensemble des acteurs, s’ajoute le manque de cohérence entre la vision du MESRS et celle du MARHP.
De ce fait, la recherche agronomique manque ainsi d’une stratégie à moyen et long terme qui fixe le cap et qui mobilise les moyens nécessaires pour son accomplissement et qui soient le fruit d’une concertation de tous les acteurs, notamment celle des deux tutelles.
Au contraire, en Tunisie, les programmes de recherche se caractérisent par leur courte vue et par une recherche à la demande qui vise plus à répondre aux demandes pressantes des agriculteurs et de leur représentation qu’à anticiper les problèmes et leur apporter des solutions.
Pour une gestion adaptée à l’activité de recherche
Le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche au MARHP représente environ 2,4% du budget annuel de ce ministère, reflétant la faible place qui y est accordée à la recherche. Ceci est d’ailleurs à l’image du reste du budget accordé à la recherche scientifique par le budget de l’Etat dans son ensemble.
Ce budget dont la plus grande part est allouée à la rémunération des enseignants-chercheurs (84 % du budget, contre 5% pour l’investissement) laisse les chercheurs devant des choix souvent difficiles en terme de priorité de recherche et les poussent à la recherche de financements complémentaires, avec ce que cela implique de perte de maitrise de l’orientation des programmes.
A cela s’ajoute les lourdeurs de gestion, puisque les instituts de recherches ont actuellement le statut d’établissements publics à caractère administratif et sont soumis de ce fait au contrôle ex- ante dans la gestion de leur budget quel que soit d’ailleurs sa provenance. Or cette procédure est incompatible avec la réactivité et la souplesse que nécessite l’activité de recherche.
Soumission à la production scientifique au détriment de son impact sur les agriculteurs
La carrière des chercheurs est déterminée principalement par leur capacité à publier dans des revues internationales de premier rang si possible. Ainsi une course à la publication est observée que renforce la volonté des universités tunisiennes d’améliorer leur position dans les classements internationaux
Cette dérive vers la publication à outrance vient d’être aggravée par l’instauration d’une prime à la production scientifique qui récompense les publications annuelles de chaque chercheur en donnant la priorité aux revues de renommée mondiale et dont l’accès aux chercheurs et surtout aux lecteurs est souvent difficile, voire payant. Cela pousse à une déconnexion complète entre la recherche et ses utilisateurs finaux.
La marchandisation de la production scientifique réalisée avec l’argent des contribuables est une source supplémentaire de confusion entre le produit de la recherche comme un bien public accessible à tous et le fait que les publications deviennent ainsi un bien privé approprié par les éditeurs des revues scientifiques.
Cette politique profite au passage aux revues prédatrices qui ont adopté le modèle économique de l’auteur payeur adossé au libre accès, en place du modèle classique du lecteur payeur.
Un rôle de plus en plus intrusif de la coopération internationale
La coopération internationale est de plus en plus déterminante dans le financement et l’orientation des programmes de recherche en Tunisie.
De ce fait les chercheurs se trouvent écartelés entre le désir de l’insertion dans la communauté scientifique internationale qui est légitime et le travail sur des problématiques nationales et une proximité avec les acteurs (agriculteurs, leur représentation syndicale, les acteurs des chaines de valeurs, etc.) qui est leur raison d’être.
En effet, faire partie de la communauté scientifique internationale, cela apporte la reconnaissance des pairs, la publication dans des revues prestigieuses et le bénéfice de financement internationaux sans commune mesure avec les budgets alloués par l’état tunisien.
Par contre cette insertion oblige souvent le chercheur à se soumettre aux injonctions des bailleurs de fonds internationaux qui gardent la maitrise du choix des thèmes prioritaires et des approches pour la conduite des projets de recherche qu’ils financent.
Il s’agit dans les faits d’un processus de délocalisation de la recherche à l’échelle internationale. Par ce biais, les programmes pilotés par les pays du Nord qui portent sur des problématiques définiesen partant de leur contexte, mobilisent les meilleurs chercheurs du Sud contre une part négligeable des financements.
En guise de conclusion
Les menaces auxquelles fait face l’agriculture tunisienne ne sont pas nouvelles, mais ce qui est nouveau c’est l’acuité avec laquelle elles se posent.
Qu’il s’agisse du changement climatique, de la prévention et la lutte contre les maladies émergentes ou encore de la dégradation des ressources naturelles (eau, sol, couvert végétal) la recherche se doit d’avoir un temps d’avance sur les problèmes et les anticiper selon les différents scénarios afin que le moment venu les agriculteurs et les autres acteurs ne se trouvent pas pris au dépourvu.
Pour répondre à ces problématiques la recherche se doit d’abandonner l’approche sectorielle poussée à l’extrême et adopter une approche plus globale des problèmes en créant ainsi des synergies entre les disciplines dans une approche systémique et prospective.
Il s’agit d’une réforme globale qui touche à la fois le mode de gouvernance, la gestion des ressources humaines et financières et celle des structures. Pour cela quelques orientations stratégiques devraient être envisagées :
- la réforme du statut des instituts de recherche avec la généralisation du statut d’établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) et le regroupement des instituts en pôles régionaux en créant des équipes atteignant la masse critique de chercheurs;
- la mise en place d’une stratégie nationale décennale de la recherche agricole, avec une loi d’orientation qui affiche les ambitions que l’on veut donner à ce secteur adossée à une loi de programmation qui donnent les moyens pour y parvenir.
- la négociation avec nos partenaires une coopération internationale qui fasse primer la solidarité et l’intérêt national avant celui des bailleurs de fonds sous le mode gagnant-gagnant;
- l’introduction de plus de démocratie dans le fonctionnement des institutions qui encadrent la recherche avec l’instauration de conseils scientifiques disposant d’une réelle représentation des chercheurs et des professionnels et d’un pouvoir décisionnel.
* Universitaire et syndicaliste.


Donnez votre avis