Il devient urgent de réinterroger les choix urbanistiques de la Tunisie pour qu’ils reflètent une vision humaine de la ville — non pas une juxtaposition d’appartements, mais une communauté vivante. Car l’architecture peut fabriquer du lien social, comme elle peut aussi le détruire. (Ph. Médina de Tunis : créer du lien social).
Zouhaïr Ben Amor *
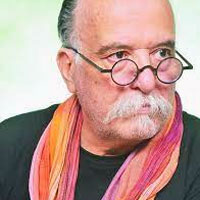
Nos villes sont les miroirs silencieux de nos âmes collectives. Elles révèlent notre rapport à l’autre, au temps, à la nature. Ce que nous appelons «urbanisme» n’est pas qu’un exercice d’ingénierie : c’est une mise en forme de notre société, une écriture invisible qui traduit nos valeurs.
La Tunisie, comme beaucoup de nations en mutation rapide, a vu son paysage urbain se transformer en quelques décennies : des médinas humaines et poreuses, nous sommes passés à des banlieues standardisées, où l’anonymat est devenu la règle. Derrière les murs des immeubles collectifs, chacun vit replié sur soi, tandis que les rues, autrefois lieux de sociabilité, se réduisent à de simples couloirs de transit.
Pourtant, l’habitat peut être un ferment de fraternité. La disposition des maisons, la présence d’une cour, d’un banc ou d’un arbre peut inviter à la rencontre. Mal pensée, l’architecture isole ; bien pensée, elle relie. Il devient donc urgent de réinterroger nos choix urbanistiques pour qu’ils reflètent une vision humaine de la ville — non pas une juxtaposition d’appartements, mais une communauté vivante.
L’urbanisme : science de l’espace, science du vivre ensemble
L’urbanisme ne se limite pas à dessiner des rues et des bâtiments. Il organise la cohabitation des individus et modèle leurs comportements. Henri Lefebvre, dans ‘‘Le Droit à la ville’’ (1968), insistait sur le fait que l’espace urbain n’est jamais neutre : il est le produit d’un rapport social. L’urbaniste ne trace pas seulement des plans, il définit les conditions de la vie collective.
Jane Jacobs, dans ‘‘The Death and Life of Great American Cities’’ (1961), a montré que la vitalité d’un quartier dépend de la présence d’espaces mixtes et d’activités diverses. Les rues animées, disait-elle, sont les plus sûres parce qu’elles sont «surveillées» naturellement par les habitants : «Eyes on the street». À l’inverse, les grands ensembles isolés, fruits d’une vision technocratique de la ville, ont engendré la désocialisation.
Le Corbusier, dans ‘‘La Charte d’Athènes’’ (1943), rêvait de villes fonctionnelles et géométriques, séparant rigoureusement les zones d’habitation, de travail et de loisirs. Ce modèle, séduisant sur le papier, a souvent produit dans la réalité des espaces sans âme.
Les théoriciens contemporains comme Françoise Choay (‘‘L’Urbanisme, utopies et réalités’’, 1965) ou Richard Sennett (‘‘Building and Dwelling: Ethics for the City’’, 2018) rappellent que l’urbanisme doit redevenir une éthique du vivre-ensemble. La ville est d’abord un organisme social, et son architecture doit refléter cette vocation.
La Tunisie urbaine : du village au bloc de béton
Jusqu’aux années 1960, les villes tunisiennes étaient des mosaïques humaines. Les médinas, avec leurs ruelles étroites, favorisaient la rencontre et la solidarité. Les maisons s’ouvraient sur des patios intérieurs, véritables cœurs battants où s’exprimait l’équilibre entre intimité et convivialité.
Mais la modernisation postindépendance a bouleversé cet équilibre. Sous l’effet de la croissance démographique et des politiques de logement de masse, on a vu surgir des cités entières à la périphérie des grandes villes : blocs d’immeubles identiques, sans âme, ni verdure, ni cœur communautaire. Ce fut la victoire du modèle «fonctionnel» sur l’humain.
Ces «cités sociales» étaient pensées pour loger, non pour relier. L’urbaniste tunisien Ali Ben Salem notait déjà dans les années 1980 que «la cité devient un refuge sans horizon, où l’habitant perd jusqu’à la mémoire du voisinage». Les équipements collectifs promis ne voient souvent pas le jour ; les espaces publics se dégradent ; les habitants vivent dans un anonymat que rien ne vient compenser.
Et pourtant, dans les villages tunisiens — Testour, Mahdia ou Houmt Souk — la convivialité demeure une seconde nature. Les gens s’y saluent, s’assoient sur le pas de la porte, partagent un café. La structure même du bâti, à échelle humaine, rend cette interaction possible. Elle enseigne une vérité simple : l’architecture peut fabriquer du lien social, mais elle peut aussi le détruire.
Quand l’architecture façonne la psychologie sociale
L’espace habité agit sur la psychologie de l’individu. Les chercheurs en psychologie environnementale, comme David Canter ou Roger Barker, ont démontré que la configuration spatiale influence la manière dont les gens se comportent, communiquent et perçoivent autrui.
Un espace lumineux et végétalisé incite à la détente ; une rue ombragée encourage la promenade ; un hall froid et vide provoque la fuite. L’absence de lieux de transition entre le public et le privé — cour, jardin, perron — engendre des existences confinées.
Les anciens habitats tunisiens avaient compris cette nécessité. Le patio, la terrasse, le banc à l’entrée de la maison jouaient le rôle d’espaces médiateurs. Ils permettaient de voir sans être vu, d’échanger sans être exposé. En supprimant ces zones intermédiaires, l’architecture moderne a créé des «non-lieux», pour reprendre le terme de Marc Augé (‘‘Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité’’, 1992).
Ces espaces neutres — parkings, ascenseurs, halls impersonnels — ne favorisent ni la rencontre ni l’attachement. Or, la qualité d’une société se mesure aussi à sa capacité à offrir des lieux de gratuité : des endroits où l’on n’achète rien, où l’on se croise simplement, où la parole circule.
La psychologie collective tunisienne souffre aujourd’hui d’une architecture qui segmente. Nos villes produisent plus d’isolement que de voisinage. Le «vivre ensemble» ne se décrète pas : il se construit, pierre après pierre, autour d’espaces qui encouragent la rencontre.
Construire autrement : vers un urbanisme relationnel
Face à la crise du lien social urbain, de nombreuses villes à travers le monde ont entrepris de repenser la manière de bâtir. On parle désormais d’urbanisme relationnel, où la priorité n’est plus la densité mais la qualité de la relation humaine.
À Medellín (Colombie), les autorités ont transformé les quartiers pauvres en y implantant bibliothèques publiques, jardins suspendus, écoles d’art et téléphériques reliant les collines au centre. Le sociologue Javier Echeverri parle de «reconstruction du tissu moral par la beauté». La criminalité a baissé, la fierté citoyenne a renaît.
À Copenhague, la conception urbaine repose sur la «ville des piétons». Selon l’architecte Jan Gehl (‘‘Cities for People’’, 2010), marcher, s’asseoir, observer, sont des actes fondateurs de la démocratie urbaine. Plus une ville encourage ces gestes simples, plus elle est humaine.
À Barcelone, le modèle des superilles (superblocs) a redonné aux habitants la maîtrise de leurs rues. La circulation automobile y est restreinte, les places publiques redeviennent des espaces de jeux et de dialogue.
Ces exemples montrent que la réussite d’une politique urbaine ne se mesure pas seulement au nombre de logements construits, mais à la qualité du lien social qu’elle engendre. Une cité vivante est un organisme où la mixité sociale, la verdure, la beauté et la convivialité se conjuguent.
Repenser les constructions sociales en Tunisie
La Tunisie connaît aujourd’hui une relance des programmes de logements sociaux. Mais trop souvent, ils reproduisent les erreurs du passé : uniformité, isolement, absence d’espaces partagés. Or, le logement n’est pas une fin en soi : c’est un cadre de vie qui influence l’éducation, la sécurité et même la démocratie locale.
Chaque projet devrait commencer par une étude sociologique :
– Qui va y habiter ?
– Quels liens sociaux existent déjà ?
– Quels usages culturels faut-il préserver ?
Un urbanisme socialement intelligent doit intégrer plusieurs éléments essentiels :
– des espaces communs ouverts et végétalisés;
– des commerces de proximité et des services intégrés;
– des écoles, ateliers, cafés culturels et bibliothèques au cœur du quartier ;
– des formes architecturales diversifiées, favorisant la mixité générationnelle et sociale ;
– et surtout, la participation des habitants à la conception du projet.
Les architectes tunisiens, nombreux et talentueux, devraient être associés à cette refondation. Des initiatives locales émergent déjà : à Sousse, le projet «Darna» tente d’introduire des cours collectives ; à Tunis, certains collectifs d’architectes proposent des «micro-espaces partagés» dans les zones densifiées. Ces tentatives montrent la voie : la cité doit redevenir un lieu de citoyenneté.
Le philosophe Paul Ricoeur rappelait dans ‘‘L’idéologie et l’utopie’’ (1986) que l’espace bâti «donne forme à nos relations sociales». En ce sens, l’État tunisien, les municipalités et les promoteurs portent une responsabilité morale : construire, c’est aussi éduquer.
Les nouvelles constructions sociales ne doivent pas être de simples logements de secours, mais des écoles de coexistence. En y intégrant des jardins communautaires, des ateliers pour enfants, des espaces de rencontre, on y sème la graine de la citoyenneté.
Bâtir la cité intérieure
Une société se lit dans ses murs. Une ville qui enferme ses habitants produit des citoyens méfiants ; une ville ouverte, verte et équilibrée engendre la confiance.
La Tunisie a un héritage architectural exceptionnel : nos médinas, nos villages, nos patios témoignent d’un art du lieu où beauté et mesure cohabitaient. Nous n’avons pas besoin de revenir au passé, mais d’en extraire la leçon : l’harmonie entre l’individuel et le collectif.
Bâtir des maisons, ce n’est pas seulement couler du béton, c’est façonner des comportements. Si nos murs sont trop hauts, nous perdrons la voix de nos voisins. Si nos places sont trop grandes et vides, nous perdrons la chaleur des rencontres.
Il faut redonner à l’urbanisme sa dimension éthique. Comme l’écrivait Richard Sennett, «habiter, c’est apprendre à composer avec les autres dans la proximité» (‘‘The Conscience of the Eye’’, 1990).
La Tunisie du futur ne se jugera pas seulement à ses lois ou à ses technologies, mais à la qualité de ses quartiers. Une cité où l’on se salue, où l’on s’assoit sous un arbre, où les enfants jouent ensemble, sera toujours plus forte qu’une cité où l’on se barricade.
Construire pour vivre ensemble, c’est bâtir la cité intérieure — celle où l’humain précède le béton, où chaque maison devient un signe d’ouverture. Si nos urbanistes savent entendre cette leçon, alors nos villes redeviendront des espaces de paix et d’hospitalité.
Références bibliographiques :
Lefebvre, Henri. Le Droit à la ville. Paris : Anthropos, 1968.
Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York : Random House, 1961.
Le Corbusier. La Charte d’Athènes. Paris : Minuit, 1943.
Choay, Françoise. L’Urbanisme, utopies et réalités. Paris : Seuil, 1965.
Sennett, Richard. Building and Dwelling: Ethics for the City. New Haven : Yale University Press, 2018.
Augé, Marc. Non-Lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Seuil, 1992.
Gehl, Jan. Cities for People. Washington : Island Press, 2010.
Ricoeur, Paul. L’idéologie et l’utopie. Paris : Seuil, 1986.
Echeverri, Javier. Urbanismo social en Medellín. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2015.



Donnez votre avis