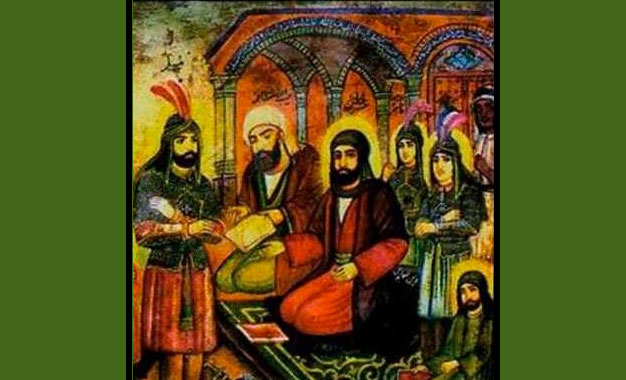
Chez Aïcha, dans une pièce fermée, les cinq prétendants étaient accompagnés d’AbdAllah, fils d’Omar, comme conseiller sans voix et d’un Renfort, le chef de guerre Abou Talha, faisant office de gendarme; les instructions du calife décédé étaient ainsi suivies à la lettre.
Par Farhat Othman
On veilla à ne laisser personne trop se rapprocher de la maison. Quand, malgré tout, Amr Ibn Al’Ass, alors encore en poste en Égypte, accompagné de son ami AlMoughira Ibn Cho’oba, en charge quant à lui d’AlKoufa, vinrent s’asseoir devant la porte, Saad Ibn Abi Wakkas sortit les prier de partir ; et comme les deux hommes renâclaient à se lever, il n’hésita pas à les chasser à coup de cailloux : — Allez-vous-en ! Leur cria-t-il. Vous vouliez pouvoir dire : nous en étions ; nous fûmes de la consultation !
La délibération fut âpre, on ne s’arrêta sur aucun choix et les regards des cinq de plus en plus se concentrèrent sur deux d’entre eux ; ils étaient tous les deux beaux-fils du prophète. Othmane l’était même doublement, ayant épousé en premières noces Rokayya puis, après sa mort, sa sœur Om Koulthoum. Ali, pour sa part, était l’époux de Fatima, mère d’AlHassan et d’AlHoussayn que le prophète chérissait particulièrement.
Après le règne des beaux-pères, on serait à la veille de celui des beaux-fils. Abou Bakr et Omar avaient l’un et l’autre le prophète pour gendre, le premier étant le père d’Aïcha, l’épouse préférée de Mohamed et le second, celui de Hafsa, une de ses épouses.
Comme tous les natifs du signe astrologique du taureau, Mohamed appréciait les bonnes choses, dont les femmes, bien qu’il demeurât d’une totale fidélité à la première – Khadija – épousée alors qu’il avait la vingtaine et décédée quelque trois ans avant son départ de La Mecque pour Médine.
Ali et Othmane étaient des cousins éloignés, le premier étant en plus le cousin germain du prophète ; et c’était particulièrement sur cette parenté qu’il se fondait pour affirmer ses prétentions à la succession. De sa paternité, il tirait une légitimité supplémentaire, AlHassan et AlHoussayn ayant été considérés par le prophète comme ses propres fils, lui qui, en dehors de trois garçons morts en bas âge, n’eut que des filles – quatre en tout – toutes issues de sa première épouse.
Opposés dans la compétition pour le pouvoir, appartenant à deux clans parents, mais traditionnellement déchirés par la sempiternelle question de la primatie tribale, ils étaient physiquement très différents aussi. De taille à peine au-dessus de la moyenne, Othmane avait les traits clairs et réguliers, légèrement marqués de la petite vérole. Ses épaules étaient larges et sa barbe bien fournie qu’il ne manquait jamais de teindre. Le milieu de sa tête était dégarni et, tout autour, longue et lisse était sa chevelure, flottante et grisonnante. Très brun, plutôt petit de taille, Ali était chauve et ventru et avait les yeux grands aux paupières lourdes.
Décidés étaient l’un et l’autre ! De ce qu’ils considéraient leur droit, ils ne voulaient rien céder ; et leurs trois concurrents ne voulaient pas être en reste. Aussi, serrés et tendus étaient les débats ; leur issue n’apparaissait pas évidente. Abou Talha, l’observateur qui faisait office de gendarme, en était tout étonné :
— J’avais bien plus peur que vous rejetiez la responsabilité du pouvoir que vous ne vous la disputiez ! Par celui qui nous a ravi Omar, non ! Vous n’aurez pas un jour de plus des trois qu’il avait décidés.
La situation était dans une totale impasse quand Abd ErRahmane Ibn Aouf osa une suggestion. Bien qu’il ne se retînt pas de participer aux discussions afin de contrecarrer les ambitions de certains, il était le moins désireux de ce pouvoir, objet de toutes les convoitises.
— Qui est prêt à se désister pour se charger de désigner le meilleur d’entre vous ?
Personne ne répondit. Il osa alors se proposer entraînant aussitôt une réaction positive d’Othmane :
— Je suis le premier à l’accepter. J’ai entendu le prophète dire « Abd ErRahmane est digne de confiance sur terre et au ciel».
À l’exception d’Ali qui gardait le silence, tous les autres acceptèrent. Alors, Abd ErRahmane Ibn Aouf s’adressa à lui :
— Qu’en dites-vous, Abou AlHassan ?
— Donne-moi l’engagement que tu opteras pour la vérité, que tu ne suivras pas la passion, que tu ne privilégieras pas ta parentèle et que tu ne manqueras point de conseiller au mieux la communauté.
S’adressant à l’ensemble de l’assistance, Abd ErRahmane Ibn Aouf dit en guise de réponse :
— Donnez-moi vos engagements d’être avec moi contre quiconque se rétractera et d’accepter ce que je vous aurai choisi.
L’issue semblant honorable à chacun, Ibn Aouf eut l’accord de tous les cinq qui le quittèrent plutôt satisfaits. Commençant aussitôt ses consultations, il demanda à voir Ali en aparté et lui demanda :
— Tu es le plus digne de cette charge eu égard à ta parenté, ton antériorité à embrasser l’islam et le bon exemple que tu donnes. Mais qui de ceux-là et après toi tu l’en penses digne ?
— Othmane, répondit-il.
Se retrouvant ensuite avec Othmane, il eut de lui une réponse équivalente à celle d’Ali qui serait le méritant du pouvoir après lui. Il se réunit ensuite en tête-à-tête avec Saad Ibn Abi Wakkas à qui il demanda son préféré. «Othmane» répondit-il. Azzoubeyr Ibn AlAwwam, à qui il posa la même question, fit une réponse similaire.
En coulisses, les tractations allaient bon train. Ali avait les plus sérieuses craintes ; il appréhendait surtout que ne se liguent contre lui Ibn Aouf, Ibn AlAwwam et Ibn Abi Wakkas. Accompagné de ses deux fils AlHassan et AlHoussayn, il alla voir ce dernier :
— Au nom de la parenté avec le prophète de mes deux fils que voilà et de tes liens avec mon oncle Hamza, je t’implore de ne pas être contre moi, l’auxiliaire d’Abd ErRahmane en faveur d’Othmane ; je te suis bien plus proche que ce dernier.
Trois nuits durant, la cité vécut dans une étrange atmosphère, inconnue jusque-là, grosse d’appétits réveillant les rivalités ancestrales d’un assoupissement qu’on prenait pour mort, remettant au goût du jour les sentiments exécrables entretenus par les clans jaloux de leurs prérogatives et assoiffés d’autorité, de commandement, ou du moins du prestige qui en était le corollaire.
Ignorant l’agitation autour de lui, Abd ErRahmane Ibn Aouf cherchait à agir consciencieusement, avec méthode. Il passa ses jours et la majeure partie de ses nuits à faire le tour des notables de Qoraïch les sondant un à un sur leurs préférences. Elles allaient presque toutes vers Othmane et cela ne le surprenait point. L’homme était, en effet, riche, généreux et affable ; à Qoraïch, on avait même coutume de dire : « Je taime, par Dieu, de l’amour que porte Qoraïch pour Othmane ».
Cela lui rappelait ce qu’avait dit un jour Omar au neveu d’Ali, Ibn AlAbbas, l’oncle du prophète. Ces paroles résonnèrent souvent dans sa tête à l’occasion de ses consultations.
— Sais-tu, Ibn AlAbbas, pourquoi votre communauté vous refuse le mérite de la gouverner alors que vous appartenez au cercle intime du prophète ? Elle trouve que vous l’avez surpassée par la prophétie et se dit que si vous y ajoutiez le califat, il ne lui resterait rien ; et c’est ce qu’elle ne peut tolérer.
La veille du troisième jour, Ibn Aouf ne dormit pas ; il veilla à consulter encore et toujours. Au petit jour, à l’arrière de la salle de prière de la mosquée, il s’entretint avec Azzoubeyr Ibn AlAwwam auquel il demanda s’il voulait laisser l’affaire se jouer entre les fils d’AbdManaf; Azzoubeyr ne refusa pas, mais dit réserver la chance lui revenant pour Ali.
S’isolant ensuite avec Saad Ibn Abi Wakkas avec lequel il se sentait une certaine proximité, jugeant cet homme – qui, tout comme lui, n’avait ni parents ni enfants – droit et intègre, il lui dit :
— Nous sommes tous les deux sans héritiers ; nous ne pouvons qu’être désintéressés. Laisse-moi choisir pour toi !
— Si c’est pour te choisir toi-même, alors bien volontiers ; si c’est pour choisir Othmane, alors je lui préfère Ali, répondit Saad.
Les deux principaux candidats pressentis n’avaient pas manqué d’efforts pour maximiser leurs chances. Si Othmane, grâce au poids de sa famille dans la tribu, avait rallié la quasi-unanimité des notables de la ville, Ali réussit à augmenter ses appuis au sein du groupe de la consultation en usant de la corde sensible du mérite de sa lignée. Abd ErRahmane Ibn Aouf ne l’ignorait pas. Il se trouvait devant un dilemme : soit écouter le choix des principales têtes de la communauté et nommer Othmane, soit comptabiliser les votes des consultants et faire passer Ali.
Malgré son désintéressement et sa loyauté à s’acquitter de la charge qui lui incombait, il ne pouvait s’empêcher d’être pessimiste quant au sort de la fonction de calife, jugeant d’avance le futur responsable des intérêts de la communauté dans l’incapacité d’égaler l’exemple de ses prédécesseurs. Il résuma cette pensée dans une parabole qu’il eut en réponse à Ibn Abi Wakkas quand celui-ci conditionna son désistement par sa propre candidature :
— Je me suis vu dans un verger herbu et verdoyant quand un bel étalon noble et digne est venu à y passer ; il le traversa comme une flèche sans que rien des richesses environnantes ne l’arrêtât. Il fut suivi par un chameau qui marcha sur ses traces jusqu’à la sortie ; puis un pur-sang fort et robuste passa tirant sa bride, se tournant à droite et à gauche, mais allant toujours dans le sens des deux précédents jusqu’à quitter le verger. Un quatrième arrivant, un chameau, entra enfin dans le verger et se mit à paître. Par Dieu, non ! Jamais je ne serai ce quatrième chameau-là ! Après Abou Bakr et Omar, personne ne saura rallier l’assentiment des gens !
Ainsi conditionnée, sa vision le conduisait à se fixer des repères pour se faire un choix. Dans l’entourage d’Othmane, l’un des hommes réputés les plus malins de sa génération était aux aguets comme à son habitude. Amr Ibn Al’Ass surveillait les gestes et les paroles du préposé au choix du futur calife et réussit à décoder son système de pensée.
À la veille du jour décisif, toute la nuit d’Ibn Aouf passa à nouveau en conversations confidentielles, d’abord avec Ali, puis avec Othmane. Avec ce dernier, il resta jusqu’à l’appel à la prière du matin ; avec le premier, il ne fit ni ne dit rien de nature à ébranler sa certitude d’être l’élu.
La prière matinale venait de se terminer ; dans la mosquée, les pronostics allaient bon train avec, apparemment, un net avantage pour le cousin du prophète. Les uns soutenaient qu’il était le seul à pouvoir éviter la division des musulmans, sa lignée, mais aussi ses propres qualités humaines et sa connaissance approfondie du Coran militant en sa faveur et lui assurant une obéissance générale. Les autres rappelaient le poids de la tribu de Qoraïch et particulièrement celui de la famille d’Othmane, affirmant qu’il n’y avait pas de meilleur choix que celui d’Othmane pour éviter la division des musulmans.
Pleine à craquer était la mosquée et impatients étaient tous les présents de connaître le choix final. Abd ErRahmane Ibn Aouf arborait le turban que lui avait offert le prophète ; il avait réuni autour de lui les quatre hommes du groupe de la consultation et tenu à ce que tous ceux qui comptaient parmi les Émigrants et les Renforts fussent présents ainsi que les chefs des armées de conquêtes de passage en ville.
— La prière en réunion !
Le cri de rassemblement pour tout événement majeur venait d’être hurlé et l’on sentit la mosquée trembler ou presque. Les clans de Hachem et d’Omeyya étaient très fébriles ; dans leur soutien inconditionnel à leur chef de file, ils n’étaient pas loin d’en venir aux mains.
Sur la première marche de la chaire se tenait Ibn Aouf ; Saad Ibn Abi Wakkas était debout, à côté. En stratège avisé, habitué aux situations explosives, il s’adressa à lui, le pressant d’en finir. De ses mains, l’interpellé demandait le silence, sans oser encore parler.
— Ne tarde plus ou ils vont se laisser aller aux pires excès !
Dans le bruit environnant, Abd ErRahmane se mit alors à invoquer le nom de Dieu, se raclant la gorge à plusieurs reprises. Comme par enchantement, le silence se fit soudain et on l’entendit dire à voix haute :
— J’ai observé et consulté et vous recommande de ne point céder au péché de la discorde.
Puis, s’adressant à Ali qui se tenait à sa droite, lui prenant la main, il demanda :
— Prends-tu devant Dieu l’engagement de n’agir que selon le livre de Dieu, la tradition de son prophète et la pratique de ses deux califes ?
— J’agirai selon le degré de mon savoir et de mes efforts, répondit Ali.
Il se tourna alors vers Othmane, debout sur sa gauche, et lui posa la même question après lui avoir pris de même la main. Pour toute réponse, il eut simplement un oui net et direct, presque timide, dit du bout des lèvres.
Levant à ce moment-là haut la tête et les mains sans relâcher celle d’Othmane, il déclara aussitôt : — Dieu m’est témoin ! Je place la responsabilité qui m’incombait autour du cou d’Othmane que je choisis.
Ali devint tout d’un coup rouge de colère ; surpris et désappointé, on l’entendit protester à haute voix :
— Tu l’as favorisé ! Ce n’est pas la première fois que vous vous mettez de connivence contre nous.
— Ali, ne te laisse pas gagner par la colère ! Rétorqua Ibn Aouf. J’ai observé et consulté les gens ; ils ne trouvaient personne à la hauteur d’Othmane.
Ali ne répondit point, lui tournant le dos, s’en allant déjà, essayant de fondre les masses qui s’agglutinaient autour de la chaire sur la première marche de laquelle se tenait désormais le nouvel élu. Il marmonnait : — Toute destinée arrive à une fin !
Mais, récité tout haut, un verset du Coran rappelant le serment de fidélité prêté par les musulmans à leur prophète à un moment critique de l’histoire de la religion naissante le fit revenir en arrière :
«Ceux qui te prêtent serment d’allégeance le prêtent en fait à Dieu ; par-dessus leurs mains est la main de Dieu. Quiconque se parjure, c’est seulement à son détriment qu’il se parjure ; et celui qui tient son engagement, Dieu le gratifiera d’une récompense sublime.»
Avec ce dixième verset de la sourate de La Conquête (Al Fath), Ibn Aouf réussit à ramener Ali vers la chaire et le vit donner la main à son concurrent puis partir précipitamment sans s’empêcher de répéter rageusement :
— C’était un piège ; et quel piège !
Entre une forte minorité osant montrer sa joie et une majorité des présents, turbulente et excessive dans sa colère, la mosquée était sens dessus dessous. Ibn Aouf avait l’air ébahi ; il gardait cependant ses certitudes. À l’un de ses proches compagnons qui commentait son choix, lui reprochant d’avoir délaissé celui qui était capable d’user de justice et de vérité, il jura avoir essayé de servir au mieux les intérêts de la communauté. Son interlocuteur n’était pas convaincu et continuait :
— Je suis étonné comment Qoraïch délaisse un homme aussi noble, aussi juste et savant, aussi respectueux de la vérité. Ah ! Si seulement j’avais des hommes armés avec moi !
— Crains Dieu et ne te laisse pas aller à susciter des troubles ! Lui recommanda simplement Ibn Aouf.
À l’écart de la foule, l’air goguenard, l’oeil de malice pétillant, un homme ne se pressait pas pour donner sa voix à Othmane ; se frottant les mains, il savourait la réussite de son stratagème. À son habitude, Amr Ibn Al’Ass usa de sa science et réussit au-delà de tout espoir.
Lors des précédents jours, feignant d’agir pour ses intérêts, il s’évertua à convaincre Ali d’adopter la stratégie gagnante qu’il lui proposait. Prétendant qu’Abd ErRahmane Ibn Aouf était un homme réfléchi et posé, prisant plus la diligence et l’effort, les considérant comme la meilleure assurance pour mener à la vérité qu’une décision et une résolution souvent porteuses d’erreurs et de précipitation, il lui déconseilla de faire montre de sa détermination habituelle et de sa volonté débordante. Dans le même temps, à Othmane, il conseillait de se départir de la souplesse et de la flexibilité le caractérisant pour montrer davantage de volonté et de fermeté.
Plus tard, dans la journée, arriva enfin Talha, le dernier des six choisis par Omar. On l’informa du choix d’Othmane. Bien conseillé, ce dernier n’exigea pas de lui son accord, lui laissant la liberté de refuser, se disant même prêt à se désister en cas de refus. Talha vérifia seulement si tout Qoraïch avait accepté son choix, si tout le monde l’avait choisi et, fataliste, laissa tomber : — J’accepte aussi ; je ne refuse point ce sur quoi les gens se sont réunis.
Othmane venait de s’assurer définitivement de la charge de deuxième prince des croyants, troisième vicaire du prophète ; il avait 72 ans. On était en l’an 23 de l’hégire, 644 de l’ère chrétienne.
À suivre…
«Aux origines de l’islam. Succession du prophète, ombres et lumières’ », roman de Farhat Othman, éd. Afrique Orient, Casablanca, Maroc, 2015.


Donnez votre avis