À chaque sommet international, les chefs d’État défilent, posent devant des drapeaux et publient des communiqués. Mais derrière ces images, une question essentielle demeure : représentent-ils seulement leurs États ou incarnent-ils aussi la dignité de leurs peuples ? Cette question doit aussi être posée à propos du Sommet arabo-islamique de Doha, organisé lundi 15 septembre 2025.
Khemaïs Gharbi *
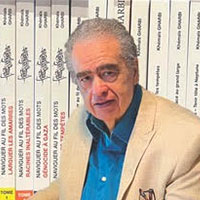
Ce sommet s’est tenu soi-disant en réponse à l’attaque israélienne qui a visé les dirigeants du Hamas dans la capitale du Qatar la semaine dernière, tuant cinq membres du mouvement de résistance palestinien et un agent de sécurité qatari. Il s’est aussi tenu à un moment crucial de l’histoire du Moyen-Orient, marqué par l’impuissance de la communauté internationale face au déchaînement guerrier de l’Etat d’Israël contre tous ses voisins. Mais à quoi a-t-il finalement abouti, sinon à la même litanie des dénonciations futiles, inutiles, lassantes et déshonorantes à la fois, car sans lendemain ?
Un pays n’est pas qu’un territoire, une armée ou un PIB. C’est d’abord un peuple, une mémoire, une histoire, une fierté. Ignorer cette dimension réduit la politique internationale à une mécanique d’alliances de circonstances et de contrats, en oubliant ce qui rend une nation vivante et debout : sa dignité.
La plupart des communiqués finaux ressemblent à des listes ennuyeuses — dénonciations, condamnations, vœux pieux. Et la déclaration finale du Sommet de Doha n’a pas dérogé à cette règle. Tout cela compte, mais si la dignité des peuples est absente de l’équation, ces décisions s’évanouissent comme du sable entre les doigts.
Les décisions sans dignité sont sans âme
La dignité n’est pas un luxe moral mais un facteur de stabilité politique, l’oxygène de peuples étouffés par l’injustice ou l’humiliation. Un peuple qui perd confiance se désespère; un peuple respecté accepte plus facilement des sacrifices temporaires.
On parle de «sauver l’honneur» dans les matchs de football, comme si ce n’était qu’un réflexe symbolique. Mais pour les peuples, l’honneur est une réalité politique. Il peut être blessé par une guerre injuste, par des sommets qui ignorent sa fierté, son honneur et sa sensibilité.
Les dirigeants qui se rendent à un sommet portent plus qu’un drapeau : ils portent la mémoire de leurs martyrs, les sacrifices de leurs soldats, les rêves de leurs populations. Cela exige courage et abnégation, car la dignité doit avoir sa place au cœur de la défense des intérêts supérieurs des peuples.
Il est temps que les sommets internationaux inscrivent explicitement la dignité des peuples à leur ordre du jour. Cela ne signifie pas rédiger de belles phrases dans un préambule : cela signifie mesurer les conséquences psychologiques et symboliques des décisions. Une décision respectueuse de la dignité d’un peuple, à un moment crucial de son existence, peut marquer des générations entières.
Vers une diplomatie du respect
Posons donc, après chaque conclave diplomatique, la question simple mais essentielle : ce sommet a-t-il préservé la dignité des peuples concernés ?
La dignité n’est pas un supplément d’âme : c’est le cœur battant de la souveraineté. Vaclav Havel l’avait résumé ainsi : «La vraie politique est celle qui place la dignité de l’homme au centre et non l’intérêt immédiat des partis ou des États.»
C’est à cette hauteur qu’il faut désormais juger nos sommets. Non pas à la taille des buffets ni au nombre de photos, mais à l’aune de ce qu’ils font pour que chaque peuple puisse se tenir debout, fier et respecté.
* Ecrivain, traducteur.



Donnez votre avis