La réunion des chefs d’État arabes et musulmans, lundi 15 septembre 2025 à Doha, se tient sous une pression inédite. Après l’attaque israélienne du 9 septembre en plein cœur du Qatar, le temps des illusions est terminé. Ce sommet ne peut plus se contenter d’effets d’annonce : il doit apporter des réponses concrètes pour calmer la rue arabe et préserver la dignité collective. Tout recul serait perçu comme une faiblesse aux conséquences durables. (Ph. Sommet arabo-islamique de Ryad en Arabie saoudite, en 2023).
Khemais Gharbi *
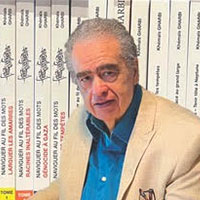
«Celui qui croit s’abriter sous le parapluie des États-Unis est en réalité sans protection.» Cette phrase attribuée à Hosni Moubarak résonne aujourd’hui avec acuité. L’attaque de Doha, qui a tué six négociateurs du Hamas et blessé plusieurs autres, a exposé au grand jour l’extrême vulnérabilité des alliés de Washington.
Le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine de la région. Pourtant, aucun des radars sophistiqués – des joujou achetés au prix d’or auprès des Etats-Unis – n’a détecté l’incursion israélienne; l’avertissement américain n’est arrivé qu’une fois les bombes tombées. Cet épisode relance une question explosive : les équipements fournis aux alliés sont-ils contrôlables à distance, rendant leur défense illusoire ? Si tel est le cas, la souveraineté militaire des États arabes dépend plus de Washington que de leurs propres décisions.
Quant à l’énorme «quincaillerie» achetée par les pays du Golfe auprès de l’industrie d’armement américaine, on est en droit de douter de son utilité, eu égard son coût exorbitant qui aurait sans doute permis à ces pays de se doter eux-mêmes d’une industrie militaire digne de ce nom, comme l’ont fait du reste la Turquie, l’Ukraine ou encore Israël.
Une architecture de sécurité fissurée
Depuis les années 1970, le pacte était clair : pétrole et investissements colossaux contre une soi-disant protection américaine d’une supposée menace iranienne (iranienne et non israélienne, cela va de soi !). La frappe sur Doha brise cette certitude fondée sur une illusion et un auto- mensonge. Si l’émirat, médiateur à la demande de Washington, n’a pas été protégé, qui le sera demain ? L’inquiétude gagne toutes les capitales présentes au sommet de lundi. Et qui sont presque toutes de supposées «alliées» des Etats-Unis.
Ce sommet est l’occasion ou jamais d’affirmer une position commune. Le parapluie militaire américain est troué et la dépendance militaire totale aux États-Unis n’est plus tenable. Les participants doivent choisir entre continuer à subir ou entamer une diversification stratégique – Chine, Russie, Turquie – et surtout renforcer une défense autonome, comme est en train de le faire du reste l’Union européenne qui ne peut plus compter, elle aussi, sur le fameux «parapluie» américain. Sans cette inflexion, chaque pays risque de devenir une variable d’ajustement dans des stratégies qui ne sont pas les siennes.
Un dernier test pour des dirigeants d’opérette
La réunion de lundi peut aussi servir de levier politique pour redéfinir la normalisation avec Israël. Après Doha, poursuivre comme avant serait perçu comme un blanc-seing donné à l’impunité. Un gel temporaire de certaines coopérations, ou au moins un signal politique fort, redonnerait de la crédibilité au camp arabe et musulman, aujourd’hui ébranlé.
La frappe contre Doha n’est pas seulement une tragédie humaine; c’est un électrochoc géopolitique. Elle rappelle que l’hospitalité diplomatique, la médiation ou l’achat d’armes sophistiquées n’offrent aucune immunité. Le véritable enjeu du sommet du 15 septembre n’est pas un communiqué commun soporifique et sans lendemain, comme savent le faire les dirigeants arabo-musulmans en mal de crédibilité politique et de légitimité démocratique, mais une stratégie collective pour reconquérir une marge d’autonomie et de décision.
* Ecrivain et traducteur.



Donnez votre avis