L’intelligence ne peut plus être réduite à un chiffre ni à une aptitude unique. Elle est plurielle, située et relationnelle. Elle est rationnelle, sociale, émotionnelle, culturelle, pratique, créative et politique. Elle est façonnée par les structures sociales, les héritages culturels et les interactions quotidiennes.
Zouhaïr Ben Amor *
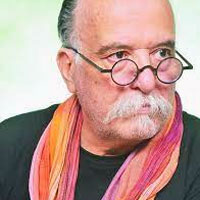
Pendant longtemps, l’intelligence a été assimilée à une faculté unique, stable et mesurable par un chiffre : le quotient intellectuel. Héritée du XIXᵉ siècle, cette vision rationaliste et mathématique a influencé aussi bien la psychologie que l’école, en hiérarchisant les individus selon leur capacité de raisonnement abstrait. Mais ce modèle, s’il a permis des comparaisons, a très vite montré ses limites. L’intelligence humaine ne se réduit pas à des opérations logiques ou à des tests de mémoire. Elle se déploie dans des situations variées : dans la relation aux autres, dans l’expression des émotions, dans l’art de comprendre des symboles ou d’inventer des solutions pratiques.
Les sciences sociales, en particulier la sociologie, ont joué un rôle central dans cette redéfinition. De Durkheim à Bourdieu, de Goffman à Foucault, sans oublier des penseurs plus récents comme Howard Gardner, Daniel Goleman ou Edgar Morin, de nombreux chercheurs ont montré que l’intelligence est multiple, contextualisée et indissociable des dynamiques sociales.
L’intelligence rationnelle : la vision classique
L’intelligence rationnelle, mesurée par les tests de QI, repose sur l’idée que la logique et la mémoire constituent l’essence même de l’esprit humain. Cette approche a dominé le XXᵉ siècle, notamment dans les systèmes éducatifs, où la réussite scolaire se confondait souvent avec la réussite intellectuelle. Pourtant, elle a été critiquée par de nombreux sociologues.
Pierre Bourdieu a démontré que les performances aux tests de QI ne reflètent pas uniquement des dispositions naturelles, mais aussi un capital culturel transmis par le milieu familial. Dans La reproduction (1970), écrit avec Jean-Claude Passeron, il souligne que «l’école transforme des privilèges sociaux en dons naturels». Autrement dit, ce que les tests présentent comme de l’intelligence innée est souvent le produit d’un apprentissage social.
De son côté, Raymond Boudon a mis en lumière les limites du modèle rationnel en sociologie. Pour lui, les comportements humains ne sont pas toujours logiques au sens strict, mais obéissent souvent à des effets pervers : des conséquences collectives non prévues par des décisions individuelles rationnelles. Ainsi, réduire l’intelligence à une aptitude logique revient à ignorer la complexité des choix sociaux.
L’intelligence rationnelle reste importante, mais elle ne suffit pas à rendre compte de toutes les dimensions de l’esprit humain. Elle ne dit rien de notre capacité à ressentir, à interagir, à créer ou à s’adapter.
L’intelligence sociale : l’art du lien et de l’interaction
L’intelligence sociale désigne la faculté de comprendre les autres, de coopérer avec eux et d’agir efficacement dans un cadre collectif. Déjà au début du XXᵉ siècle, Émile Durkheim insistait sur le fait que l’homme n’est pas seulement un individu isolé, mais un être social. Sa notion de conscience collective illustre cette dimension : «Ce n’est pas seulement en chacun de nous, mais dans la société que réside l’intelligence» (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912).
Plus près de nous, Erving Goffman a montré dans La mise en scène de la vie quotidienne (1956) que chaque interaction repose sur une sorte de théâtre où chacun joue un rôle. Savoir gérer son image, interpréter les signaux d’autrui, anticiper ses réactions : voilà autant de formes d’intelligence sociale.
Aujourd’hui, cette intelligence est particulièrement précieuse. Dans les entreprises, elle se manifeste à travers le leadership, la négociation ou le travail d’équipe. Dans les réseaux sociaux numériques, elle est mise à l’épreuve par la capacité à se présenter de manière crédible et attractive, mais aussi à éviter les conflits ou les malentendus. L’intelligence sociale est donc une condition indispensable pour naviguer dans les sociétés complexes et interconnectées.
L’intelligence émotionnelle : réguler et exprimer ses affects
Popularisée par le psychologue Daniel Goleman dans les années 1990, l’intelligence émotionnelle renvoie à la capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles d’autrui. Contrairement à une idée reçue, les émotions ne sont pas des faiblesses irrationnelles. Elles sont au cœur de la vie sociale.
La sociologue Arlie Hochschild, dans The Managed Heart (1983), a introduit le concept de travail émotionnel : dans certaines professions, comme les hôtesses de l’air ou les infirmiers, il est attendu de contrôler ses affects pour répondre aux attentes du public. Sourire malgré la fatigue, rassurer malgré l’angoisse : voilà des formes d’intelligence émotionnelle socialement prescrites.
Cette intelligence joue aussi un rôle crucial dans la famille, l’éducation et la santé mentale. Elle permet de prévenir les conflits, d’apaiser les tensions et de créer des relations solides. Dans un monde où les interactions sont multiples et souvent rapides, elle constitue une ressource essentielle pour maintenir l’équilibre personnel et collectif.
L’intelligence culturelle et symbolique : décrypter les codes sociaux
L’intelligence culturelle est indissociable de la pensée de Pierre Bourdieu, notamment à travers ses concepts de capital culturel et d’habitus. Elle désigne la capacité à comprendre et utiliser les codes, les références et les symboles propres à un milieu.
Dans La distinction (1979), Bourdieu montre que les goûts et préférences esthétiques, loin d’être naturels, sont le produit d’un apprentissage social. Savoir apprécier un concert de musique classique ou un tableau abstrait n’est pas universel : c’est une compétence acquise. Celui qui la possède dispose d’un avantage social, car il peut circuler dans des milieux cultivés et y être reconnu.
Dans un monde globalisé, l’intelligence culturelle prend une dimension nouvelle. Elle permet de s’adapter dans un environnement multiculturel, de dialoguer avec des personnes aux références différentes et de créer des ponts entre traditions. Comprendre un rite religieux, interpréter un signe vestimentaire ou décoder un discours politique suppose une compétence symbolique. Sans elle, l’individu risque le malentendu, l’exclusion ou l’incompréhension.
L’intelligence pratique : les savoir-faire incorporés
Loin des raisonnements abstraits, l’intelligence pratique concerne les compétences incarnées dans le corps et l’action. Le sociologue Marcel Mauss, dans son essai Les techniques du corps (1934), a montré que des gestes aussi simples que marcher, nager ou porter un fardeau ne sont pas universels, mais appris et transmis socialement.
Cette intelligence se manifeste dans les savoir-faire artisanaux, agricoles ou techniques. Le maçon qui ajuste un mur, le menuisier qui sent la résistance du bois, l’agriculteur qui lit le ciel ou la terre : tous mobilisent une forme d’intelligence pratique, difficilement mesurable par des tests de QI.
Dans nos sociétés technologisées, on a parfois tendance à négliger cette dimension. Pourtant, elle reste essentielle. La pandémie de Covid-19, par exemple, a montré l’importance des métiers dits «manuels», capables de produire, réparer et maintenir les infrastructures vitales. L’intelligence pratique assure la continuité matérielle de la société.
L’intelligence créative et esthétique : innover et imaginer
L’intelligence créative désigne la faculté de produire de la nouveauté, qu’il s’agisse d’idées, d’objets ou d’œuvres d’art. Elle est au cœur de l’évolution culturelle et scientifique.
Le sociologue Howard Becker, dans Art Worlds (1982), rappelle que la création artistique n’est pas le fait d’un génie isolé, mais le résultat d’un réseau de coopération entre artistes, institutions, marchands, critiques et publics. L’intelligence créative est donc collective autant qu’individuelle.
Edgar Morin, quant à lui, insiste sur la complexité et la créativité comme moteurs de l’humanité : «La pensée complexe est inséparable d’une pensée créative» (La Méthode, 1977-2004). Imaginer, c’est aussi relier des éléments disparates pour produire du sens nouveau.
L’intelligence créative se retrouve dans les arts, mais aussi dans les sciences et l’innovation technique. L’inventeur qui conçoit une machine, le chercheur qui formule une nouvelle hypothèse, ou encore l’écrivain qui invente un univers mobilisent tous cette capacité. Sans créativité, aucune société ne pourrait se renouveler.
L’intelligence politique et collective : comprendre le pouvoir
L’intelligence politique correspond à la capacité de comprendre les rapports de pouvoir, d’anticiper les stratégies des acteurs et de mobiliser les foules. Elle est indissociable de la vie collective.
Michel Foucault a montré, dans Surveiller et punir (1975) et Histoire de la sexualité (1976-84), que le savoir est toujours lié au pouvoir. Comprendre ces mécanismes suppose une intelligence critique, capable de déceler les dispositifs de domination.
De son côté, Antonio Gramsci, dans ses Cahiers de prison (1929-1935), insistait sur le rôle des intellectuels organiques, figures capables de traduire les aspirations populaires en un projet politique cohérent. Cette intelligence collective s’incarne dans les mouvements sociaux, les syndicats, les associations citoyennes.
L’intelligence politique est donc une compétence de mobilisation et d’analyse, indispensable pour transformer la société. Sans elle, les individus risquent de subir passivement les rapports de force.
L’intelligence artificielle : une remise en question
L’essor de l’intelligence artificielle bouleverse notre conception de l’intelligence. Les machines surpassent déjà l’homme dans certains domaines, comme le calcul, la reconnaissance d’images ou l’analyse de données massives. Mais peut-on pour autant parler d’«intelligence» ?
La sociologue Shoshana Zuboff, dans The Age of Surveillance Capitalism (2019), a montré que l’IA tend à réduire les comportements humains à des données exploitables à des fins économiques. Loin de reproduire la complexité des intelligences humaines, elle les simplifie pour mieux les contrôler.
Les machines n’ont ni émotions, ni créativité authentique, ni conscience sociale. Elles complètent certaines tâches humaines, mais ne remplacent pas la richesse des intelligences multiples. Le défi contemporain est de trouver un équilibre entre ces deux formes d’intelligence, afin que l’IA serve l’humain sans l’asservir.
Conclusion : reconnaître la pluralité des intelligences
L’intelligence ne peut plus être réduite à un chiffre ni à une aptitude unique. Elle est plurielle, située et relationnelle. Elle est rationnelle, sociale, émotionnelle, culturelle, pratique, créative et politique. Elle est façonnée par les structures sociales, les héritages culturels et les interactions quotidiennes.
Les sociologues nous rappellent que l’intelligence est indissociable des contextes dans lesquels elle se déploie. La société ne doit pas valoriser uniquement la logique abstraite, mais aussi les émotions, la créativité, les savoir-faire pratiques et la capacité à coopérer.
À l’heure de l’intelligence artificielle, ce défi devient plus pressant. Reconnaître la pluralité des intelligences humaines, c’est préparer une société plus juste, où chacun peut contribuer selon ses forces et ses talents. C’est aussi une manière de résister à la tentation de réduire l’humain à des algorithmes et des chiffres.
Comme le rappelle Edgar Morin, «il faut apprendre à naviguer dans la complexité». Cette navigation suppose d’articuler toutes nos intelligences, pour que l’humanité continue à inventer, à aimer, à coopérer et à se transformer.
* Dr en biologie marine.
Bibliographie
- Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude (1970). La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris : Éditions de Minuit.
- Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.
- Boudon, Raymond (1977). Effets pervers et ordre social. Paris : PUF.
- Durkheim, Émile (1912). Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : Alcan.
- Foucault, Michel (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris : Gallimard.
- Foucault, Michel (1976-1984). Histoire de la sexualité, 3 tomes. Paris : Gallimard.
- Gardner, Howard (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York : Basic Books. [Traduction française : Les intelligences multiples, Retz, 1997].
- Goffman, Erving (1956). The Presentation of Self in Everyday Life. New York : Doubleday. [Traduction française : La Mise en scène de la vie quotidienne, Minuit, 1973].
- Gramsci, Antonio (1929-1935). Cahiers de prison. Éd. critique, Paris : Gallimard, 1996.
- Hochschild, Arlie Russell (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley : University of California Press.
- Mauss, Marcel (1934). Les Techniques du corps. Journal de Psychologie, 32(3-4).
- Morin, Edgar (1977-2004). La Méthode (6 volumes). Paris : Seuil.
- Becker, Howard S. (1982). Art Worlds. Berkeley : University of California Press. [Traduction française : Les Mondes de l’art, Flammarion, 1988].
- Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence. New York : Bantam Books. [Traduction française : L’intelligence émotionnelle, Robert Laffont, 1997].
- Zuboff, Shoshana (2019). The Age of Surveillance Capitalism. New York : PublicAffairs. [Traduction française : L’Âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2020].


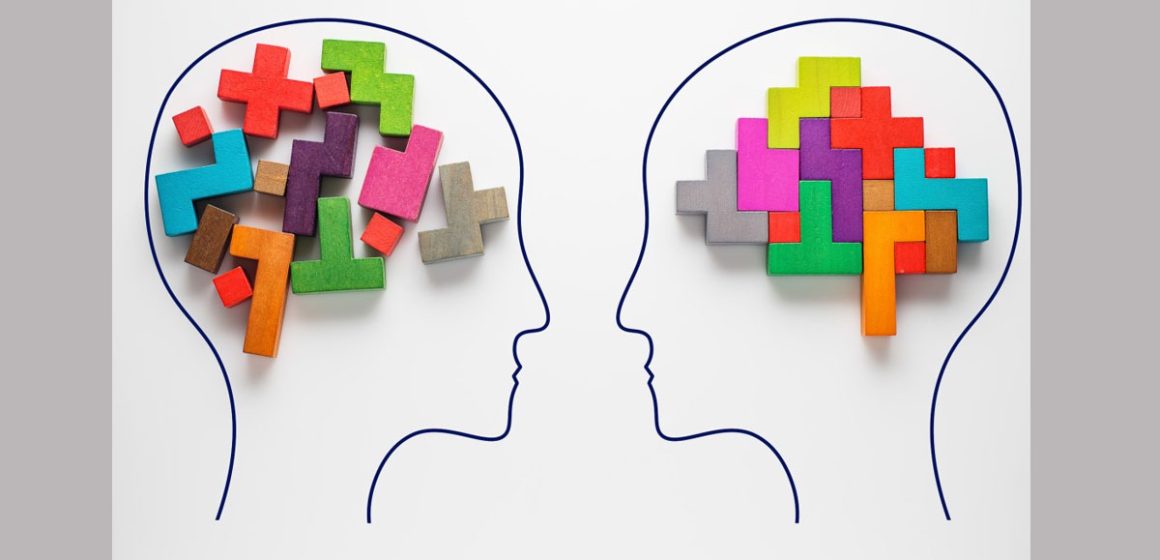
Donnez votre avis