Nous vivons une époque de bouleversements où l’Histoire semble s’accélérer. Le monde entier change à la fois politiquement et géographiquement. Les cartes géostratégiques sont rebattues et une redistribution des forces s’opère, non plus par le droit ou la concertation, mais à coups de menaces, de chantage économique et de pressions militaires. Le slogan est lancé: «la paix par la force» en s’affranchissant du droit international. (Ph. Donald Trump / Vladimir Poutine / Xie Jinping / Narendra Modi).
Khémaïs Gharbi *
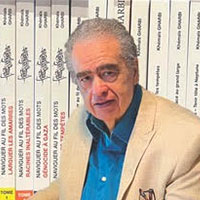
À l’instar des années 1940, nous sommes à la veille d’un nouveau «Yalta» : une reconfiguration du monde dictée par le poids des armées et des arsenaux des grandes puissances prédatrices.
Face à cette mécanique implacable, les petits pays paraissent fragiles. Pourtant, l’Histoire nous enseigne que certains remparts, quand ils sont solidement érigés, peuvent leur donner une force insoupçonnée.
Premier rempart, le soutien populaire
C’est sur la division intérieure que misent toujours les grandes puissances pour imposer leur hégémonie. Les exemples abondent : en 1953, l’Iran de Mossadegh, malgré sa volonté de garder la main sur son pétrole, a été fragilisé par des tensions internes attisées de l’extérieur, ce qui facilita le coup d’État. À l’inverse, le Vietnam, dans les années 1960-70, a montré que la cohésion nationale, même au prix de terribles sacrifices, pouvait résister au rouleau compresseur américain. Un peuple uni, qui croit en la légitimité de ses dirigeants dans les moments critiques, peut offrir aux gouvernants la crédibilité nécessaire pour repousser les chantages et préserver l’indépendance nationale.
Deuxième rempart, les alliances
L’Histoire moderne est riche d’exemples où des États de taille modeste ont trouvé une protection dans des alliances solides. La Suisse, au cœur de l’Europe, a su jouer des équilibres et préserver son intégrité grâce à un savant dosage de neutralité et d’accords discrets. Plus récemment, les pays baltes, après leur indépendance, n’ont trouvé la garantie de leur sécurité qu’en rejoignant l’Otan et l’Union européenne. Pour un petit pays, l’isolement est synonyme de vulnérabilité; la solidarité régionale ou internationale, au contraire, double sa résilience.
Troisième rempart, le patriotisme
Il ne s’agit pas ici de chauvinisme aveugle, mais de la capacité d’une nation à transcender ses querelles internes quand une menace extérieure se profile. Dans l’Angleterre de Churchill, les rivalités politiques furent suspendues au nom de l’unité face à l’Allemagne nazie.
De même, dans le monde arabe, l’Égypte de Nasser, lors de la nationalisation du canal de Suez en 1956, a montré combien l’unité nationale pouvait être une arme redoutable. Face à l’agression tripartite menée par la France, la Grande-Bretagne et Israël, le peuple égyptien s’est rassemblé derrière son dirigeant, transformant l’humiliation attendue en victoire politique. Cette cohésion interne, doublée du soutien populaire massif, a forcé les puissances prédatrices à battre en retraite sous la pression internationale. L’unité nationale, quand elle devient réflexe vital, transforme un pays menacé en forteresse morale.
Ultime rempart, la diplomatie
La diplomatie est l’arme des faibles face aux forts, mais à condition d’être pensée avec intelligence et constance. De petites nations ont su compenser leurs faiblesses militaires par une diplomatie inventive. Le Costa Rica, par exemple, a renoncé à une armée en 1949 pour faire de la paix son identité et de ses alliances internationales son bouclier. La Tunisie, à plusieurs reprises dans son histoire récente, a utilisé l’art de la négociation et de l’équilibre entre puissances rivales pour préserver son indépendance et attirer des soutiens.
La diplomatie ne remplace pas la force brute, mais elle peut désamorcer une crise, gagner du temps, et surtout empêcher qu’un pays ne soit enfermé dans le goulot d’une bouteille dont il ne sortirait qu’à ses dépens.
Le monde de demain ne sera pas plus tendre que celui d’hier. Mais il n’est pas écrit que les petits États soient condamnés à subir. Leur survie et leur dignité dépendront de leur capacité à conjuguer unité nationale, alliances stratégiques, patriotisme réfléchi et diplomatie inventive. Car si Yalta fut imposé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, l’avenir, lui, reste ouvert à ceux qui sauront bâtir ces remparts invisibles, mais décisifs.
* Ecrivain et traducteur.



Donnez votre avis