La récente prière collective d’élèves dans la cour du lycée Mohamed Boudhina de Hammamet, qui a suscité une vive polémique, n’est pas un simple incident disciplinaire. C’est le signe visible d’un manque de repères symboliques et spirituels qui fragilise nos jeunes. Et au-delà de la gestion institutionnelle, il révèle une faille plus profonde : l’oubli du sens et l’absence d’une véritable intelligence spirituelle dans notre système éducatif. Quand l’école oublie de former à l’intelligence spirituelle, elle produit des diplômés compétents mais désarmés face aux dogmes.
Manel Albouchi *

Les Lumières sont arrivées jusqu’à nous, mais comme des valises étrangères. Sans histoire. Sans enracinement.
À l’école, on apprend par cœur des versets du Coran, on récite Voltaire, on mémorise des théorèmes. Mais pense-t-on vraiment ?
Depuis l’indépendance, l’école tunisienne a repris les modèles coloniaux et modernisateurs. Le savoir y est réduit à un instrument utilitaire, souvent simple levier d’ascension sociale. Le diplôme en devient l’horizon unique. On apprend aux élèves à réussir aux examens, à accumuler des savoirs techniques, mais rarement à se poser des questions de sens.
Comme le dit Edgar Morin, une éducation réduite à la transmission de connaissances techniques est incomplète : elle oublie ce qui relie les savoirs entre eux, ce qui relie l’homme à sa culture et à sa propre intériorité.
Ainsi, notre école a certes permis l’ascension sociale, mais elle a aussi produit une génération d’esprits brillants mais déracinés, flottant entre le vide et le dogme.
La dimension manquante
L’intelligence spirituelle ne peut se réduire à un courant de pensée, à un dogme ou à une religion. Elle inclut la sagesse, l’intuition et la conscience de la transcendance, c’est-à-dire du lien avec ce qui nous dépasse.
Le psychologue Robert Emmons a montré que l’intelligence spirituelle est la capacité à mobiliser des ressources intérieures pour affronter les épreuves, donner du sens à sa vie et transformer la souffrance en croissance.
Pour Danah Zohar et Ian Marshall, le Spiritual Quotient (SQ) est «l’intelligence ultime», celle qui intègre toutes les autres : raison, émotion, intuition. Sans elle, l’homme reste prisonnier de ses conditionnements; avec elle, il accède à une véritable liberté intérieure.
C’est cette dimension qui manque aujourd’hui. Sans intelligence spirituelle, nous formons des diplômés brillants mais fragiles, capables de résoudre des problèmes techniques, mais incapables d’habiter leur vie avec cohérence et profondeur. L’élève est alors comme une feuille emportée par le vent des dogmes : tantôt soumise, tantôt révoltée. Avec elle, il apprend à se tenir debout dans le monde, même au cœur des tempêtes.
Un langage du vide
L’incident de Hammamet n’est pas un simple problème de discipline. Il dit quelque chose de plus profond : l’absence d’un langage intérieur qui aide les jeunes à articuler leur foi, leur liberté et leur vie sociale.
Comme l’a montré Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, l’homme peut survivre à tout s’il trouve un sens. À l’inverse, le vide existentiel rend vulnérable aux idéologies et aux certitudes rigides. Ce n’est donc pas seulement la loi qui doit s’imposer à l’école, mais le sens : une boussole intérieure qui protège du fanatisme et du nihilisme.
La transmission vivante et le sacré oublié
Avant l’école moderne, le sens se transmettait par les récits, les contes, les mythes. Comme l’explique Mircea Eliade, le mythe n’est pas une fable, mais un récit fondateur qui relie l’homme au sacré.
Le rôle des mères était central : elles transmettaient mémoire et sens par leurs paroles. Par leurs berceuses et récits, elles offraient à l’enfant plus que du lait : une mémoire et une inscription dans l’histoire symbolique du groupe.
Aujourd’hui, cette parole vivante a presque disparu, remplacée par des écrans et des savoirs fragmentés. La conséquence est claire : une génération privée de repères symboliques, donc plus fragile face aux dogmes.
Le chemin de l’individuation
L’intelligence spirituelle ne se manifeste pas toujours tôt. Elle surgit souvent après les épreuves, dans la maturité. Carl Gustav Jung a parlé du Soi, centre organisateur de la psyché, qui se révèle progressivement dans le processus d’individuation.
Individuer, c’est intégrer ses contraires : raison et intuition, émotion et réflexion. C’est ce chemin qui permet de résister aux dogmes, non pas par rejet, mais par discernement.
Ainsi, l’éducation doit préparer ce terrain. Non pas seulement transmettre des savoirs, mais ouvrir un espace où raison, créativité, émotion et quête de sens peuvent dialoguer.
Réhabiliter le sens à l’école
Réformer l’école tunisienne, ce n’est pas seulement changer des programmes ou moderniser des infrastructures. C’est redonner aux jeunes une boussole intérieure.
L’intelligence spirituelle est cette couronne qui ordonne toutes les autres intelligences, nourrit la liberté intérieure et protège contre la soumission aveugle.
Sans elle, nous formons des diplômés efficaces mais orphelins de sens. Avec elle, nous donnons à nos enfants la capacité de réussir, mais surtout d’exister pleinement
* Psychothérapeute, psychanalyste.


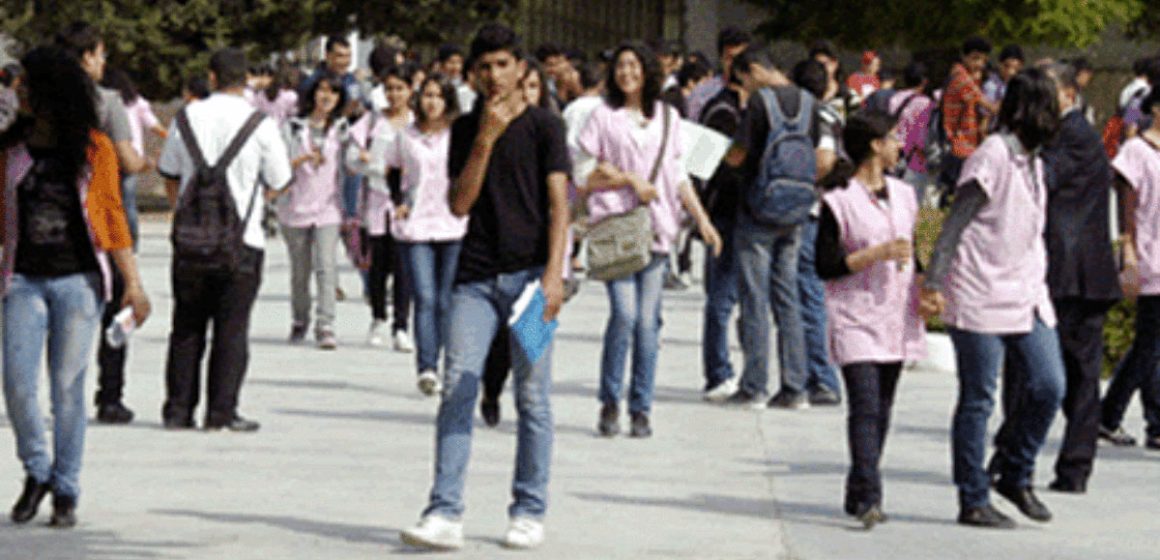
Donnez votre avis