L’Etat français, laïque par excellence, a laissé toute latitudes aux congrégations catholiques, interdites ou d’activités fortement réglementées en France, pour ouvrir des établissements d’enseignement scolaires et universitaires dans les pays militairement occupés ou liés par des capitulations, autrement dit des régimes juridiques spéciaux pour les ressortissants des puissances étrangères.
Par Dr Mounir Hanablia
C’est une vieille histoire qui a débuté avec les croisades et les royaumes francs du Levant. Elle s’est poursuivie avec l’alliance franco-ottomane contre l’Empire Espagnol au XVIe siècle, puis avec les «capitulations» obtenues sous Louis XIV au XVIIe du Grand Turc. Mais depuis la défaite face aux Russes en 1774 et le traité de Kujjuk Kenarji, les Ottomans avaient dû concéder aux puissances chrétiennes le rôle de protecteurs des minorités de leur Empire.
Il y avait certes eu l’expédition de Napoléon Bonaparte en Egypte qui s’était soldée par un revers militaire, et dont la mémoire universelle avait surtout conservé le déchiffrement des hiéroglyphes, alors que la population arabe avait été fortement marquée par la science militaire supérieure des français, au point d’inspirer au Khédive Mohammed Ali, les réformes qu’il entreprendrait pour moderniser son pays et en faire la principale puissance de l’islam, susceptible de conquérir la Grèce et d’abattre l’Empire Ottoman.
Mais c’est avec la conquête de l’Algérie en 1830 que la France a administré pour la première fois un pays dont 98% de la population professait comme religion l’islam.
Plus tard avec la conquête du Maroc en 1912, celle du Liban et de la Syrie en 1920, elle avait eu l’opportunité d’établir des rapports de domination, certes, avec les peuples vaincus, mais chaque territoire avait été le théâtre d’expériences différentes, en fonction autant des contraintes politiques métropolitaines que des conjonctures locales.
Ainsi l’Etat français, laïque par excellence, a laissé toute latitudes aux congrégations catholiques, interdites ou d’activités fortement réglementées en France, pour ouvrir des établissements d’enseignement scolaires et universitaires dans les pays militairement occupés ou liés par des capitulations, autrement dit des régimes juridiques spéciaux pour les ressortissants des puissances étrangères.
Organisation d’une foi étrangère
L’Algérie, le premier territoire musulman envahi, fut ainsi celui qui subit le plus de dégâts parce que la politique néophyte de l’Etat français, prise entre «un anticléricalisme qui n’est pas un article d’exportation» (Gambetta) et «une volonté d’amener les populations à son propre niveau de tolérance et de connaissances» (franc-maçonnerie), ne savait pas exactement ce qu’elle voulait, du moins au début.
On a ainsi commencé par une administration sous autorité militaire qualifiée de «bureaux arabes» chargée d’encadrer la population, de lever les impôts, d’assurer la justice, de soigner les malades, mais aussi de limiter les déplacements des tribus et de confisquer les terres.
Dans le même temps, les biens Habous ayant été expropriés au bénéfice de l’Etat français, l’enseignement traditionnel musulman a été déstructuré, les médersas et les kouttabs fermés, la langue arabe et le Coran n’ont plus été enseignés, poussant certaines élites à s’exiler. Plusieurs dizaines d’étudiants algériens se sont ainsi expatriés à Fès, à Tunis, au Caire, ou à Damas, dont ils revenaient auréolés de leurs diplômes de l’enseignement religieux, mais surtout imprégnés d’idées anticoloniales ou panislamiques que l’administration coloniale jugeait subversives. C’est ce qui l’a poussée à créer de toutes pièces un clergé musulman (cheikhs, imams, muftis) rémunéré par ses soins, sans être régulièrement salarié, afin de s’en assurer la fidélité en en maintenant les membres sous la menace du licenciement.
Ainsi le très laïque Etat français, dont les lois interdisaient la subvention de toute activité religieuse, s’est il retrouvé à rémunérer l’organisation d’une foi étrangère perçue comme hostile.
Effectivement, entre 1830 et 1850, la population musulmane algérienne, outre les opérations militaires endurées et les massacres qualifiés de «politique la terre brûlée» qui a fait près de 600.000 morts, a subi le choc d’une tentative de déracinement la privant parallèlement de tout apport culturel de substitution. Et à côté de ce clergé musulman l’Etat français a joué la carte des notables à qui on a parfois confié la collecte des impôts et qui intercédaient auprès de l’administration pour en obtenir des emplois dans les administrations ou les permis nécessaires aux activités commerciales ou libérales, quitte à fermer les yeux sur leurs pratiques frauduleuses ou clientélistes, ou bien encore sur leur corruption.
Administration au service du grand colonat
Sur le plan juridique, les «sujets français» de la colonie n’avaient eu le droit d’accéder à la citoyenneté que sur demande, en renonçant au recours à la loi coutumière, charaïque ou tribale, autrement dit en se plaçant en marge de leur communauté.
Il est vrai que Napoléon III conseillé par Ismaël Urbain et les Saint-simoniens avait reconnu la spécificité de l’Algérie, qualifiée de Royaume Arabe, mais l’établissement du cadastre censé protéger les populations locales les avait en fait livrées aux abus de l’administration opérant pour le compte du grand colonat.
Dans tout cela l’instruction des populations n’a jamais constitué la priorité. A l’indifférence du début à l’égard des Arabes dont on ne savait que faire en en espérant les départs, s’était substituée la volonté d’abord de les contrôler, puis de les assimiler.
C’est dans ce contexte que la question de l’éducation s’était avérée cruciale, en particulier celle du «clergé» musulman dont pour s’assurer de sa loyauté on jugeait préférable de le former dans des écoles dites «franco arabes» plutôt qu’ailleurs dans les universités islamiques du monde arabe. Mais c’est à partir de la IIIe république française avec Jules Ferry qu’un effort éducatif sans précédent a été fait afin d’étendre l’enseignement de l’école publique laïque à toutes les catégories de la population sans distinction de race ni d’origine. Mais en Algérie la proportion des élèves musulmans n’y a jamais dépassé 5%. Et il est vrai que beaucoup d’Algériens préféraient garder leurs enfants pour les travaux dans les champs, ou bien les envoyaient suivre l’enseignement musulman traditionnel qui dans le contexte colonial menait à une impasse, mais contrairement au précédent en sauvegarderait la foi religieuse; d’autant que dans le même temps, et depuis l’arrivée du Cardinal Lavigerie à la tête du diocèse d’Alger en 1867, un corps des Pères Blancs avait été créé avec mission de convertir les musulmans, particulièrement en Kabylie.
Echec de la christianisation de la Kabylie
On avait en effet beaucoup fantasmé sur ce peuple kabyle, après en avoir écrasé les révoltes dans le sang (Lalla Fatma Nsoumer, El Mokrani) et confisqué 40.000 km2 de terres, qu’on avait qualifié d’auvergnats de l’Algérie descendants des Romains et d’origine chrétienne; on avait comparé Takfarinas à Vercingétorix. Des écoles missionnaires, des pensionnats, des orphelinats, des centres éducatifs et de formation professionnelle, un effort missionnaire et d’éducation sans précédent y avait été fait, afin de le christianiser et de le franciser. Mais au final seuls quelques centaines s’étaient convertis, en général des orphelins, et après quelques décennies le constat d’échec s’était avéré inévitable.
On avait alors changé le fusil d’épaule en essayant de jouer sur les spécificités kabyles afin de créer une minorité ethnique francisée et un effort de scolarisation considérable avait été entrepris autant par l’école laïque que les Pères Blancs. L’ethnologue avait pris la place du missionnaire.
En fait, la Kabylie allait constituer la région où un maquis anti-français dirigé par Krim Belkacem se constituerait quatre années avant le début de la lutte de libération nationale.
En Orient, c’est cette même politique communaliste que l’Etat français suivrait en Syrie et au Liban, des pays il est vrai constitués d’une mosaïque de communautés le plus souvent reconnues par la Sublime Porte. Toujours est-il que seuls près de 15% des Algériens musulmans à la veille de la première mondiale parlaient le français alors que 5% étaient familiarisés avec l’arabe littéraire. Et il a fallu la saignée des combats de la Marne et du Chemin des Dames où les Allemands avaient été stoppés grâce à la bravoure des combattants maghrébins (560.000 soldats dont 17% de tués, 4 citations avec drapeaux décorés par la croix de guerre sur 20, pour 5% des combattants) pour que l’Etat français consente à la construction d’une mosquée et d’un institut musulman à Paris.
Les trois exils des juifs algériens
A titre de comparaison, la communauté juive avait été arrachée à sa culture judéo-arabe et judéo-espagnole et à la fin du XIXe siècle son taux de scolarisation atteignait 70% grâce aux écoles de l’alliance israélite universelle éduquant en français et dispensant des cours d’hébreu, mais non pas d’arabe. Grâce à quoi, et avec le décret Crémieux leur accordant automatiquement la nationalité, les juifs algériens étaient devenus, contrairement aux musulmans, juridiquement des «sujets», des citoyens français à part entière, au point de préférer quitter leur pays d’origine à l’indépendance.
L’historien juif algérien Benjamin Stora a parlé de trois exils, de la nationalité, de la langue, et du sol. Mais il faut reconnaître que l’Algérie avait été un laboratoire de la colonisation française dans un territoire musulman, où les techniques de la contrainte avaient été poussées à leurs limites les plus extrêmes, militaires et administratives, pour ouvrir le pays aux européens, et psychologiques afin de transformer les autochtones en zombies sans mémoires cantonnés dans les limites qu’on voudrait bien leur concéder qui ne dépassent pas dans les assemblées consultatives et les collèges des représentants le tiers des voix européennes.
La double autorité au Maroc et en Tunisie
Au Maroc l’action française s’est en revanche traduite d’une toute autre manière. Sous l’impulsion de Lyautey, les missionnaires ont été interdits dans le Bled Siba, l’autorité du Sultan émir des croyants consolidée avec en particulier l’écrasement des révoltes de Ma El Aïnin et de Ahmed El Hiba, les décisions du Résident général se faisant toujours sous son autorité formelle et requérant sa signature.
A l’administration chérifienne traditionnelle s’est surajoutée une autre coloniale possédant certes tous les pouvoirs de décision mais le pays n’a jamais été menacé de perdre son âme, son unité, ni ses structures politiques. Seul le Dahir berbère de 1930 a tenté de miner l’autorité du souverain en essayant d’instaurer dans les tribus une autorité judiciaire autonome, chose qui a déclenché l’ire des nationalistes alliés au palais.
Néanmoins une élite musulmane et juive éduquée dans les écoles françaises laïques ou religieuses avait émergé mais sans jamais renier ses origines et n’avait jamais accepté de constituer un recours contre les indépendantistes.
C’est cependant en Tunisie depuis 1881 avec le régime du protectorat que la politique française de la main de fer dans le gant de velours avait été structurée; elle conservait une apparence au pouvoir tunisien, celle du bey, mais c’est évidemment l’administration coloniale qui en accaparait la réalité, en particulier en s’assurant le contrôle de l’économie et de la terre, grâce aux lois votées sous l’impulsion du lobby colonial influent dans le corps législatif français et disposant de la majorité des voix dans les collectivités locales et le conseil consultatif.
Là aussi une minorité juive massivement éduquée et francisée avait émergé, à l’exception des juifs djerbiens qui avaient tenu à conserver leur personnalité originelle, mais la population musulmane, s’estimant menacée dans son identité par l’accès à la nationalité française ou dans sa foi par les missionnaires chrétiens aux initiatives provocatrices telles que le congrès eucharistique, avait le plus souvent refusé l’enseignement français, et les élites tunisiennes qui avaient émergé, quoique très minoritaires, avaient fait leurs classes dans les nouveaux établissements scolaires tunisiens modernes tels le Collège Sadiki qui aux sciences profanes associaient l’enseignement de la langue arabe.
Les Tunisiens éduqués en dehors de l’enseignement islamique de la Zitouna ne seraient pas nombreux, ils joueraient néanmoins un rôle prépondérant dans la lutte pour l’indépendance.
La carte des minorités ethniques au Levant
Au Liban et en Syrie, la politique française avait joué la carte des minorités ethniques et religieuses déjà reconnues sous l’empire ottoman. Elle avait d’abord créé un Etat confessionnel au Liban où la minorité Maronite qu’elle soutenait détiendrait l’essentiel du pouvoir, une minorité fortement francisée grâce à l’enseignement dispensé par les Jésuites, mais qui ne renoncerait jamais à l’arabe, en particulier dans sa pratique liturgique.
En Syrie l’occupation avait tenté de morceler le territoire en créant des états Ethniques propres aux minorités y résidant, en particulier sunnite, druze, alaouite, kurde, turc. Mais face au nationalisme syrien et panarabe prédominant dans la population, et mis à part l’attribution du district d’Alexandrette à la Turquie, ce projet avait été mis en échec, malgré le recours massif de l’administration coloniale aux minorités dans les forces de police et dans l’armée.
Les minorités considérées comme hérétiques par les Sunnites, telles que les Alaouites et les Druzes, quoique souvent persécutées, ont ainsi donné une leçon inoubliable de patriotisme, en refusant de s’allier au colonisateur, un fait historique dont le souvenir aurait dû faire obstacle à l’actuel conflit confessionnel syrien. En fin de compte, c’est un État syrien unitaire qui en 1946 avait accédé à l’indépendance.
Emergence du sentiment panarabe en Egypte
Le cas Egyptien a quant à lui ceci de particulier que la France, bien que n’ayant jamais exercé une domination politique directe, avait néanmoins réussi à acquérir une influence certaine depuis les réformes entreprises par l’Etat de Mohamed Ali et ses successeurs dont l’ouverture du Canal de Suez constituerait l’apogée.
L’enseignement assuré par les congrégations catholiques et l’éducation allait constituer la marque distinctive d’une élite cosmopolite musulmane, copte, juive, levantine, et européenne unies dans la pratique de la langue française.
Néanmoins la minorité juive contrairement à ce qui s’était passé au Maghreb avait conservé ses racines locales et l’usage de la langue arabe; quelques-uns de ses membres avaient fait état d’opinions nationalistes vantant la place de l’arabe dans leur sentiment patriotique égyptien.
Par ailleurs, la faculté de droit enseignant le code Napoléon avait fourni les cadres naturels de la justice capitulaire égyptienne. Mais l’émergence du sentiment panarabe et la décision du gouvernement égyptien à partir de 1952 de dénoncer les capitulations, d’arabiser l’enseignement, d’uniformiser la justice et de nationaliser des pans entiers de l’activité économique avaient évidemment poussé la plupart des minorités à émigrer, à la différence de la plus importante parmi toutes, les Coptes, dont la pratique de l’arabe dans le quotidien, l’enseignement, et l’administration, constituait une manifestation normale de son attachement à son pays.
Pour conclure, on peut certes nuancer la classification par l’auteur de l’islam en trois catégories, officiel, populaire (maraboutique, confrérique), et salafiste, ce dernier étant supposé être à l’origine des revendications indépendantistes, une hypothèse contredite par l’implication des diplômés de l’éducation française et des minorités dans les luttes de libération nationale.
Comme toujours, l’écriture de l’Histoire obéit aux préoccupations des historiens, et naturellement celle qui anime ce livre est évidemment la question de l’émigration et de l’intégration des populations qui en sont issues, dont le salafisme semble constituer le problème irréductible.
La solution de la question de l’islam
Ce que l’auteur dit, c’est que l’expérience coloniale de la France ne doit plus être occultée, et peut constituer une source d’inspiration pour la solution de la question de l’islam, à tout le moins en France. Certes ! Mais peut on considérer comme telle celle de l’État espagnol entre le XVe et le XVIIe siècles face aux Morisques, ou bien celle de l’État serbe face aux Bosniaques ou aux Albanais ?
Pour le Maghrébin contemporain, lui aussi préoccupé par les thèses islamistes pour qui les rapports avec la France se situent en droite ligne avec les Croisades, il s’avère que celle-ci, en dépit des horreurs de la colonisation, a fait œuvre utile en créant un clergé subventionné par l’autorité publique qui a permis de surmonter les questions épineuses de l’abolition du Califat et de la confiscation des biens Habous ou Waqf par les Etats nationaux issus de la décolonisation. Cette organisation religieuse coloniale perdure en Tunisie, en Algérie.
La résurgence de ces questions au Maghreb depuis le printemps arabe n’est néanmoins plus perçue comme inhérente à l’orthodoxie religieuse, mais comme une manifestation de l’opportunisme politique des islamistes, que leur incapacité à résoudre les problèmes des populations et leur implication dans les guerres civiles a complètement discrédités.
Le combat de ces derniers au nom du respect de l’identité arabo-islamique mise à mal par la laïcité a ainsi pris un caractère surréaliste, le régime colonial français ayant constamment été tout sauf laïque.
En revanche, en tolérant la corruption et les passe-droits des Caïds et des Khalifes, sinon en l’encourageant, le colonisateur a introduit le ver dans le fruit de l’administration de l’Etat de l’Indépendance dont celui-ci continue de pâtir.
D’autre part, s’il apparaît que l’État français a bien cherché à jouer la carte du communalisme, en Syrie, au Liban, et en Kabylie, il a également consolidé l’unité du Maroc, et envers et contre tout, celle de l’Etat algérien indépendant.
Si la question du langage a été un souci constant du colonisateur dans sa recherche de l’affaiblissement du colonisé musulman afin de saper sa capacité de résistance face à sa dépossession de son propre pays, ce sont bien les nouvelles élites maîtrisant la langue française qui ont souvent contribué d’une manière décisive aux luttes de libération nationale au Maghreb, et au Machrek, les minorités clientes, en particulier les Maronites et les Grecs orthodoxes, ont joué un rôle décisif dans la consolidation de la langue arabe.
Enfin depuis l’apparition de l’internet et des réseaux sociaux et l’analyse instantanée et massive grâce à des algorithmes informatiques toujours plus puissants des données statistiques, il apparaît que face à la culture consumériste standardisée issue des images en provenance d’outre-Atlantique, et l’usage des sabir personnalisés qu’elle rend accessible aux analphabètes, la question de l’influence occulte et de la manipulation des esprits a dépassé celle de la langue et de la religion, et impose la recherche de solutions inédites.
‘‘La France en terre d’islam. Empire colonial et religions, XIXe-XXe siècles’’, essai de Pierre Vermeren, éd. Belin, Paris 2016, 432 pages.


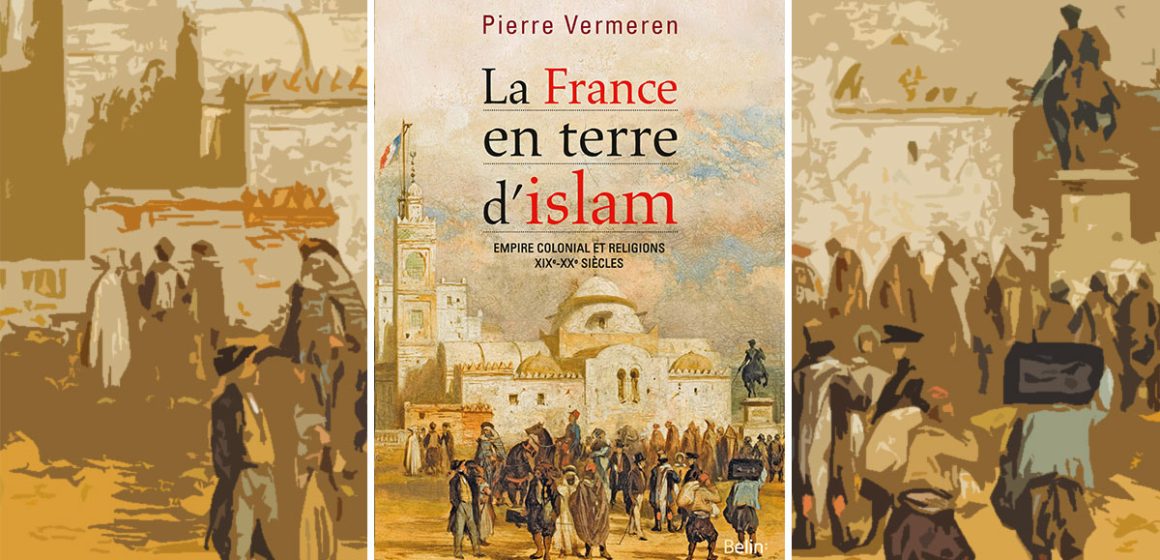
Donnez votre avis