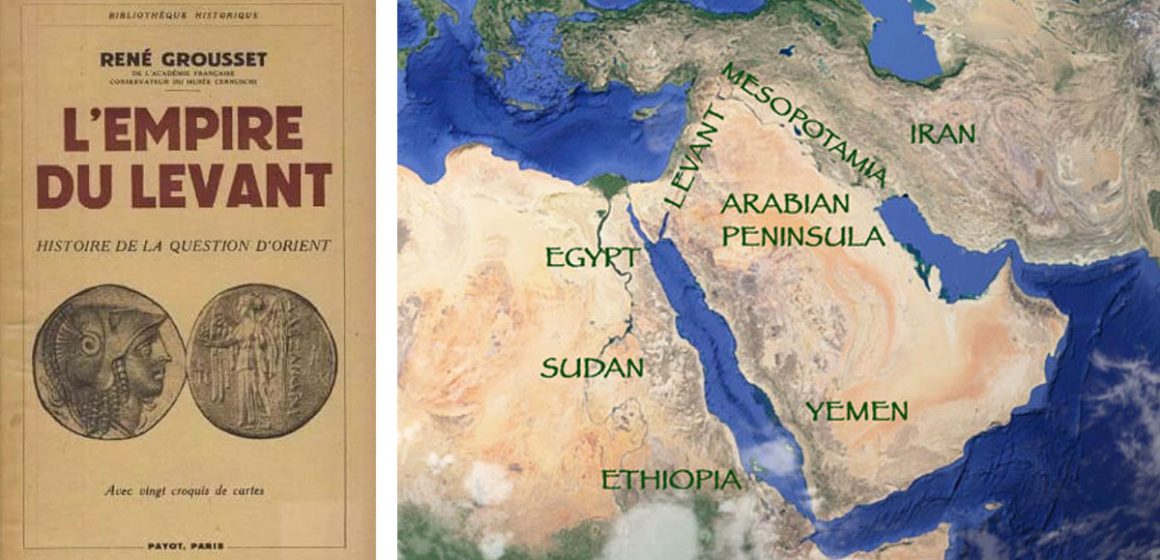Avec la création de l’Etat d’Israël, la question d’Orient est demeurée comme une plaie béante depuis le Moyen Âge. La vision fondamentale d’un danger en provenance de l’Est et menaçant l’Occident dont Israël prétend être l’avant-garde, a eu comme conséquences les plus récentes les guerres à Gaza mais aussi en Ukraine.
Dr Mounir Hanablia
La question d’Orient n’a pas débuté avec l’islam, et c’est l’un des mérites de ce livre que de le démontrer. C’est déjà une telle complexité que de la définir. Il faudrait pour ce faire adopter la vision romaine de la guerre à l’Est, héritière elle-même de celle des Grecs, et reprise par ce qu’on a plus tard appelé l’Europe, ou l’Occident.
Selon cette vision, la menace est apparue lorsque les armées Perse avaient débarqué en Attique pour subjuguer Athènes qui soutenait la révolte des cités sœurs d’Asie Mineure contre le despotisme du Grand Roi. Il en avait résulté ce que l’on avait qualifié de Guerres Médiques menées par les Rois de Perse Darius et Xerxès pour réduire la confédération de cités libres qui en Grèce s’étaient dressées contre eux.
Ces cités-Etats qui s’étaient défendues victorieusement avaient ensuite été réunies de force sous l’autorité du Roi de Macédoine, permettant ainsi la conquête de l’Asie Mineure, de l’Egypte, du Croissant Fertile, de la Perse, jusqu’aux confins de l’Inde.
Après la mort d’Alexandre de Macédoine, son empire s’était disloqué, et il en avait émergé quelques Etats importants fondés par ses généraux comme celui des Séleucides qui en Orient avaient introduit et parfois imposé les normes grecques, politiques (importance de la cité) architecturales, philosophiques (vision centrée sur l’homme, recherche au sens de la vie, de la nature), parfois linguistiques (adoption de la langue grecque).
Le choc des impérialismes
On avait qualifié cela de civilisation hellénistique, dont la frontière politique fluctuait en Mésopotamie, entre les hautes vallées de l’Euphrate et du Tigre, au gré des batailles entre les Gréco macédoniens séleucides, et un peuple de l’est de l’Iran fondateur d’un empire s’étendant jusqu’en Asie Centrale, les Parthes. Mais les Romains, après les guerres puniques, avaient réduit l’Etat séleucide à un protectorat centré sur la Syrie et s’étaient retrouvés face-à-face avec les Parthes aussi bien en Mésopotamie qu’en Arménie, un pays à substrat ethnique essentiellement iranien qui allait acquérir une personnalité politique propre en s’érigeant en royaume.
Les guerres contre Mithridate et Tigrane au Ier siècle avant l’Ère Universelle (E.U.) avaient permis d’étendre l’influence plus ou moins directe de Rome au gré des protections, des alliances, des annexions, jusqu’en mer Noire. Elles avaient annoncé l’ère des flux et des reflux entre Romains et Iraniens durant plusieurs siècles de Babylone à Byzance sans que jamais aucun des deux adversaires ne remportât de victoire décisive.
A Rome avait succédé Byzance devenue chrétienne et aux Parthes les Sassanides dotés d’une église nationale zoroastrienne. Le choc des impérialismes s’était donc doublé d’une rivalité religieuse et cela quatre siècles avant l’avènement de l’islam, il faut le préciser, qui ne fera que se substituer aux Perses qu’il aura supplantés dans la guerre contre les Byzantins.
Après la victoire du Yarmouk, la frontière entre Arabes et Grecs se déplacera de nouveau de la Cilicie (Sud Est méditerranéen de la Turquie) à l’Arménie, au Caucase, à la Haute Mésopotamie, et même à la Syrie Palestine avec la constitution de l’émirat Hamdanide d’Alep. Deux tentatives de conquête de Byzance par les califes Muawiya et Suleiman se solderont par des échecs.
Cependant, à partir du XIe siècle de l’E.U. l’arrivée des Turcs Oghuz originaires d’Asie Centrale et leur conversion à l’islam allait rompre l’équilibre militaire établi par quatre siècles de guerre. Le plateau anatolien allait progressivement se transformer en un nouveau Turkestan avec la formation d’un premier empire à cheval sur l’Anatolie, l’Iran et l’Irak, celui des Seldjoukides.
Après la débâcle de Manzikert en 1071, l’empire Byzantin, incapable de s’opposer militairement aux Turcs, faisait appel aux puissances européennes et latines pour le défendre, donnant ainsi le coup d’envoi à ce qu’on allait appeler improprement Croisades. En réalité, celles-ci furent des entreprises de colonisation économique et territoriale menées par la noblesse essentiellement française avec des moyens militaires non seulement au détriment des Arabo-musulmans en Syrie Palestine, mais aussi des Grecs avec la prise de Constantinople en 1204 par les Croisés, devenue pendant 57 ans capitale d’un royaume latin, et la création par les Français d’un royaume à Chypre après la débâcle de Palestine de 1291, et de multiples principautés en Grèce et dans les îles de la mer Egée qui passeront à la postérité sous le nom de Morée, et qui perdureront tant bien que mal pendant près de deux siècles et demi jusqu’à la conquête finale de Constantinople par Mohamed Ier le Conquérant en 1453.
Les frontières politiques du Moyen-Orient
Il importe de savoir que ces principautés françaises ou franques, mise à part celle d’Edesse (Raha) qui représente une anomalie territoriale éphémère, celles d’Antioche en Syrie, Tripoli, Beyrouth, Acre, et Jaffa, Jérusalem et Moab, n’ont fait que reproduire grossièrement les frontières politiques actuelles du Moyen-Orient issues des accords de Sykes Picot, celles privant la Mésopotamie et l’Iran de tout accès terrestre vers la Méditerranée, ou vers l’Egypte.
Ainsi les racines judéo-chrétiennes de l’Occident se sont elles traduites sur le terrain par des frontières politiques s’efforçant à une exception près, Lattaquié en Syrie, de priver l’Asie musulmane de tout débouché méditerranéen. *
Quant à l’Egypte, elle a été en butte à pas moins de quatre tentatives de conquête, deux à partir du royaume de Jérusalem, une de Chypre, et une autre par le roi Louis IX de France en 1249. Il faut dire que les Mamelouks avaient débarqué deux fois à Chypre, dont l’une pour rétablir sur son trône le Roi Jacques II dit le bâtard. Il y a donc depuis le Moyen Âge une obsession égyptienne en Europe qui s’est sans doute transmise aux Anglo-saxons avec la conquête normande.
Fait important, la colonisation des Francs au Moyen-Orient s’est efforcée de s’appuyer sur les Arméniens contre les Grecs et les musulmans, et dans une moindre mesure, sur les Syriaques, ces Arabes chrétiens monophysites qui ont souvent été persécutés par les orthodoxes mais qui n’ont jamais eu de représentation politique.
Bien avant les massacres de 1915 les arméniens, monophysites et non orthodoxes, ont été les grandes victimes de la politique byzantine en étant déportés par l’empereur byzantin Basile II, surnommé le coupeur de têtes bulgares, au XIe siècle, de la Grande vers la petite Arménie, puis les victimes de la politiques des Francs d’Antioche en s’alliant aux conquérants mongols gengiskhanides.
L’auteur avaient regretté que les Croisés, effrayés par leur férocité, n’en eussent pas fait autant, afin d’abattre l’islam. Cela a valu aux Arméniens la destruction de leur royaume de Cilicie par les Mamelouks, et la conversion de leurs protecteurs, les Mongols d’Iran, à l’islam, n’a pas servi leurs affaires.
La question des minorités au Moyen-Orient a ainsi toujours constitué une carte aux mains des puissances coloniales, dont, l’exemple des Kurdes le prouve, elles n’ont pas fait le meilleur usage.
Un autre aspect de la colonisation franque a été le rôle joué par les puissances commerçantes maritimes italiennes, Gênes et Venise, à la recherche d’avantages économiques en Grèce et en Palestine. Les Génois regroupés dans une société par actions, la Giustiniani ou Mahona, avaient pris le contrôle de Chypre, par le biais du port de Famagouste, en en confisquant tous les échanges commerciaux, réduisant l’île à la misère. Seul le débarquement égyptien l’en avait débarrassé. Les cités italiennes s’étaient érigées en intermédiaires obligés du commerce entre l’Asie et l’Europe, aussi bien en Méditerranée qu’en Mer Noire, en Crimée, et dans la mer d’Azov à l’embouchure du Don. L’actuelle guerre en Ukraine intéressant justement ces mêmes régions rappelle non seulement toute leur importance mais aussi celle d’Istanbul et des Dardanelles.
Pour conclure, si l’on suit le cheminement intellectuel de l’auteur, critiquable malgré son érudition, avec la création de l’Etat d’Israël, la question d’Orient est demeurée comme une plaie béante depuis le Moyen Âge. La vision fondamentale d’un danger en provenance de l’Est et menaçant l’Occident dont Israël prétend être l’avant-garde, a eu comme conséquences les plus récentes les guerres à Gaza mais aussi en Ukraine. On a argué des guerres médiques pour justifier l’impérialisme gréco-romain. Force est d’admettre que c’est un argument fallacieux; ni Carthage ni l’Egypte n’avaient participé à Marathon, aux Thermopyles ou à Salamine. C’est bien l’occupation gréco-macédonienne puis romaine du Moyen-Orient, considérée par l’Occident comme civilisatrice, y compris d’un empire aussi civilisé que celui des Perses, qui a depuis l’antiquité déclenché des guerres perpétuelles en Arménie, dans le Kurdistan actuel, en Mésopotamie, et en Palestine, dont les soulèvements en Judée et la destruction de Jérusalem en 70 de l’E.U., il convient de le dire, n’ont été que quelques épisodes que les sionistes contemporains, en mettant en exergue l’antisémitisme, feignent d’oublier.
Les juifs n’avaient jamais admis les idoles introduites dans leurs cités, la consommation de porc, ni le culte rendu aux César romains. L’islam, l’auteur lui même l’admet, n’a été que la réaction politique d’apparence religieuse à cette sujétion politique et militaire de la Méditerranée orientale dont les Croisades ont été la continuation, que les querelles théologiques sur la nature du Christ n’ont fait qu’exacerber.
Irruption de la supériorité militaire européenne
L’échec de la colonisation européenne au Moyen-Orient est ainsi attribué au manque d’effectifs de peuplement, plusieurs croisades ayant été interceptées en Anatolie par les guerriers turcs, dont l’irruption sur la scène de l’Histoire constitue selon lui le deuxième facteur d’échec. C’est là une explication simpliste des événements. Si le plateau anatolien est devenu turc c’est probablement parce que, à l’est, le peuplement grec y fut peu dense, et d’autre part le facteur de la conversion des Grecs à l’Islam, qui a joué un si grand rôle dans la puissance de l’empire ottoman, malgré le sérieux revers infligé par l’invasion de Tamerlan en 1402, a été totalement passé sous silence.
Si on s’en souvient, la défaite des Byzantins en Afrique du Nord fut largement due à leur politique d’oppression fiscale. Néanmoins le Turc a continué à faire figure d’envahisseur, opérant en «bandes», ce qui comparativement aux «compagnies» aragonaises et navarraises envoyées par le Royaume de Naples et ayant sévi en Grèce et en Asie mineure, témoigne d’un parti-pris indéniable et déplacé; alors que l’empire ottoman, qui s’est situé en droite ligne de l’Empire Byzantin autant dans l’architecture de ses mosquées que dans les méthodes cruelles utilisées par ses princes pour éliminer leurs rivaux dans la course au trône, ou dans le blocage de l’accès aux Iraniens devenus chiites, vers la Méditerranée ou la Mésopotamie, fut à bien des égards multinational, regroupant des Serbes, des Bulgares, des Grecs, des Albanais, des Valaques, jusqu’à ce que l’irruption du nationalisme moderne et la supériorité militaire européenne le contraignît à se cantonner aux seuls Turcs. Et si on veut voir dans l’Histoire du Moyen-Orient un affrontement entre chrétiens et musulmans, il ne faut pas oublier que ce sont les Bulgares, un peuple chrétien, qui firent échouer plus que tout autre le royaume latin de Constantinople après la conquête de la ville par les Croisés, à l’instigation de Venise, il convient de le dire.
Il faudrait donc rechercher d’autres causes à cet échec occidental qui n’en finit pas de se perpétuer ainsi que l’a illustré l’occupation américaine de l’Irak. Lorsque la France avait occupé l’Algérie en 1830, elle partageait déjà cinq siècles d’expérience coloniale au Levant. On en a vu le résultat.
Le Moyen-Orient, berceau de l’écriture, a été une terre de grandes civilisations ayant influencé durablement la Grèce et Rome. Néanmoins l’idéologie occidentale contemporaine, si on peut la qualifier ainsi, continue de l’ignorer. C’est là un aveuglement dont le monde n’a pas fini de supporter les conséquences.
‘‘L’Empire du Levant, Histoire de la question d’Orient’’ de René Grousset, éd. Payot, Paris, mars, 1992 656 pages.